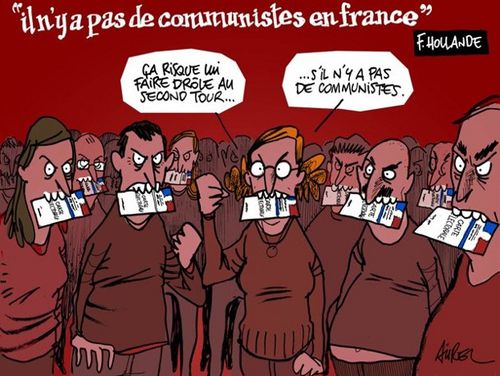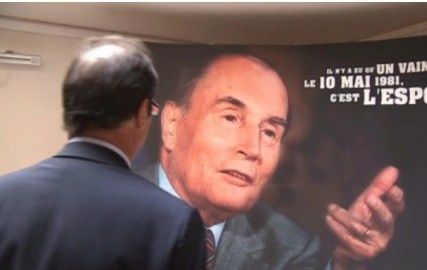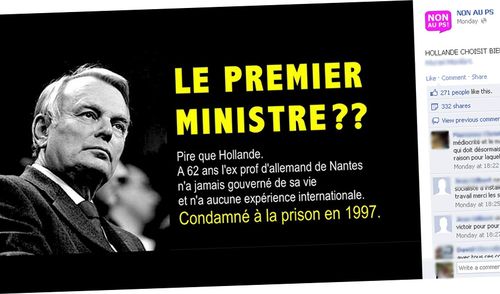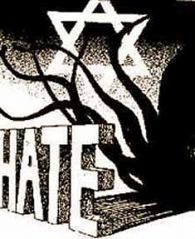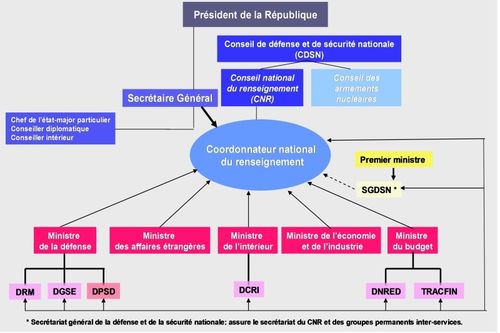Certes, les marins, comme leurs collègues aviateurs et terriens, auraient préféré éviter une nouvelle compression de leur format, tout comme une
énième réduction d’effectifs. Evidemment, certains problèmes ne sont pas solutionnés et des trous capacitaires sont à prévoir, alors que des composantes risquent de fonctionner à flux tendu
et qu’il va falloir réduire la voilure pour les opérations extérieures. Malgré tout, le projet de loi de programmation militaire adopté le 2 août en Conseil des ministres se révèle, dans le
contexte actuel, tout à fait acceptable pour la Marine nationale. Comme d’ailleurs pour les autres armées qui, à l’image de la flotte, conservent leurs grandes capacités et le maintien de
l’essentiel des programmes devant assurer la modernisation des équipements. On observe ceci dit un certain nombre de décalages dans les commandes et d’étalement de livraisons, ainsi que de
réelles coupes quantitatives dans le matériel. Moyennant quoi, au regard de la situation économique du pays et de l’impérieuse nécessité de réduire la dette publique, ce dénouement est
presque inespéré pour les militaires. Ceux-ci ont réellement évité le pire, c'est-à-dire l'abandon pur et simple de certaines grandes capacités et l'annulation de programmes majeurs. Cela,
grâce à un ministre proche du secteur et qui a su défendre son budget auprès du président de la République, tout en bénéficiant probablement de l’arrivée opportune de Bernard Cazeneuve
(ancien député-maire de Cherbourg) au ministère de Budget.
![Jean-Yves Le Drian lors de la présentation du projet, le 2 août (© : MINDEF) Jean-Yves Le Drian lors de la présentation du projet, le 2 août (© : MINDEF)]()
Jean-Yves Le Drian lors de la présentation du projet, le 2 août (© : MINDEF)
Un projet qui doit maintenant être acté par le parlement
Le projet de LPM va, cet automne, être examiné par le parlement, députés et sénateurs pouvant modifier le texte avant son vote, que le
gouvernement espère avant la fin de l’année. Le document présenté par Jean-Yves Le Drian le 2 août reste donc un projet, qui doit être pris comme tel, avec une relative prudence.
A priori, l’Assemblée nationale et le Sénat devraient entériner l’essentiel des propositions. Mais des surprises ne sont pas à exclure, d’autant que certains parlementaires n’ont guère
apprécié les annonces du ministre qui, avant même que le projet de LPM soit débattu par la représentation nationale, a fait plusieurs déclarations présentées sous forme de décisions gravées
dans le marbre. Un procédé peu conforme aux institutions de la Vème République, qui donnent au seul parlement le pouvoir de légiférer. Par conséquent, au sein notamment des Commissions
en charge de ce dossier à l’Assemblée et au Sénat, on compte bien prendre le temps qu’il faut pour examiner sérieusement le projet de loi et, si besoin, proposer des amendements pour le faire
évoluer. Avec au passage la ferme intention de rappeler au gouvernement que le parlement n’est pas une « caisse enregistreuse ».
![La FREMM Aquitaine (© : MICHEL FLOCH) La FREMM Aquitaine (© : MICHEL FLOCH)]()
La FREMM Aquitaine (© : MICHEL FLOCH)
190 milliards pour les 6 prochaines années
Le projet de LPM prévoit pour la Défense un budget global de 190 milliards d’euros (en euros courant) entre 2014 et 2019, avec un maintien des
dépenses au niveau actuel (31.4 milliards d’euros) pour les années 2014 et 2015, puis une légère augmentation ensuite. Avec, en moyenne, plus de 17 milliards consacrés annuellement aux
équipements. Sur l’ensemble de la période, 6.1 milliards d’euros doivent provenir de « ressources exceptionnelles » constituées de cessions d’emprises immobilières, de crédits provenant
du programme des Investissements d’avenir, de la vente aux enchères de fréquences radio, comme des redevances versées par des opérateurs privés pour les fréquences déjà cédées. Pourront s’y
ajouter d’éventuelles cessions de participations dans les entreprises du secteur de la Défense dont l’Etat est actionnaire. Si ces fameuses recettes exceptionnelles ne furent pas
totalement au rendez-vous dans la précédente LPM, où elles étaient déjà présentes, Jean-Yves Le Drian assure que, cette fois-ci, ce sera le cas.
![(© : MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE) (© : MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE)]()
(© : MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE)
Réduction d’effectifs
Concernant les effectifs, une nouvelle décrue est programmée afin de soutenir le redressement des comptes publics. En plus des 54.000
suppressions de postes déjà entérinées dans la précédente loi de programmation, le projet de LPM prévoit une réduction supplémentaire de 23.500 postes d’ici 2019. En 10 ans, le ministère de
la Défense devrait donc avoir supprimé 77.500 postes. On notera cependant que les recrutements vont se poursuivre, à un rythme moins soutenu toutefois, et que certaines capacités vont
voir leurs effectifs renforcés, comme les forces spéciales, où 1000 commandos supplémentaires sont prévus d'ici 2019. A cette date, l'objectif du ministère de la Défense est de ramener ses
effectifs à 242.279 hommes et femmes, contre environ 280.000 aujourd'hui. La diminution correspond aux 23.500 suppressions de postes prévues dans le projet de LPM, auxquels s’ajoute le
reliquat des 54.000 de la loi précédente qui n’ont pas encore été supprimés, soit 10.175 postes.
Le ministre a précisé le 2 août qu’il voulait un impact le plus faible possible sur les forces de combat, dont il souhaite qu’elles contribuent,
au maximum, à un tiers de l’effort global. Le reste sera gagné sur les fonctions de soutien et les services centraux (administration, états-majors…). Quant à la répartition pour chaque armée
des réductions d’effectifs, elle ne sera connue qu’en septembre. Idem pour les implantations appelées à être fermées à partir de 2014. Des mesures compensatoires et d’accompagnement sont
prévues et budgétées pour les personnels et les territoires touchés par ces mesures.
![Véhicule de l'armée de Terre en attente de déploiement à Toulon (© : EMA) Véhicule de l'armée de Terre en attente de déploiement à Toulon (© : EMA)]()
Véhicule de l'armée de Terre en attente de déploiement à Toulon (© : EMA)
Nouveau contrat opérationnel
Traduction en termes de moyens du dernier Livre Blanc sur la Défense, approuvé par le président de la République en avril dernier, la LPM fixera
pour la période 2014-2019 les missions confiées aux forces armées françaises et les capacités dont elles disposeront afin d’y répondre. Au niveau du « contrat opérationnel », le
projet adopté le 2 août en Conseil des ministres prévoit un socle de cinq missions permanentes :
- La Connaissance et l’Anticipation, avec des capacités de veille stratégique et de
maîtrise de l’information, ainsi que des moyens de surveillance et d’interception électromagnétique renforcés.
- La Dissuasion, avec toujours deux composantes, la Force océanique stratégique (FOST) et
ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), ainsi que les forces aériennes stratégiques (FAS) et la Force aéronavale nucléaire (FANU) mise en œuvre depuis le porte-avions Charles de
Gaulle.
- La Protection, avec des postures permanentes de sûreté terrestre, aérienne et maritime
tenues « dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui » précise le projet de LPM, ainsi qu’un renfort des forces de sécurité intérieure comprenant jusqu’à 10.000 hommes de l’armée de
Terre, appuyés par des éléments aériens et maritimes adaptés au contexte.
- La Prévention, avec un déploiement naval permanent dans une à deux zones maritimes (au
lieu de deux à trois actuellement), le pré-positionnement outre-mer et à l’étranger de forces terrestres, ainsi que des moyens aériens et maritimes en fonction des circonstances.
- L’Intervention, avec capacité de réaction autonome aux crises. Un échelon national
d’urgence de 5000 hommes sera en alerte pour constituer une force interarmées de réaction immédiate (FIRI) de 2300 hommes.
Dans le même temps, le ministère de la Défense détaille ses objectifs quant aux opérations extérieures. D’abord, la gestion de crise, avec une
présence dans la durée de l’armée française sur deux ou trois théâtres distincts, dont un « en tant que contributeur majeur ». Les moyens prévus se composent de forces spéciales,
d’unités de soutien, de 6000 à 7000 hommes de l’armée de Terre (avec des engins blindés à roues, chars médians, moyens d’appui feu et d’organisation du terrain, hélicoptères d’attaque et de
manoeuvre), d’une frégate, d’un groupe amphibie articulé autour d’un bâtiment de projection et de commandement (BPC), d’un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) si nécessaire ; ainsi que d’une
douzaine d’avions de chasse, répartis sur les différents théâtres d’engagement.
![L'armée de Terre engagée au Mali en 2013 (© : EMA) L'armée de Terre engagée au Mali en 2013 (© : EMA)]()
L'armée de Terre engagée au Mali en 2013 (© : EMA)
![Rafale et Mirage de l'armée de l'Air pendant les opérations en Libye en 2011 (© : EMA) Rafale et Mirage de l'armée de l'Air pendant les opérations en Libye en 2011 (© : EMA)]()
Rafale et Mirage de l'armée de l'Air pendant les opérations en Libye en 2011 (© : EMA)
![Commandos marine (© : MARINE NATIONALE) Commandos marine (© : MARINE NATIONALE)]()
Commandos marine (© : MARINE NATIONALE)
Toujours capable d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, l’armée devra également, sur une durée limitée, pouvoir soutenir une opération
majeure de coercition, prévue pour être menée au sein d’une coalition internationale sur un théâtre d’engagement unique et dans un contexte de combats de haute intensité. Cela, avec un
préavis évalué aujourd’hui à six mois environ, permettant de préparer le déploiement en incluant la possibilité de réarticuler les moyens affectés aux opérations déjà en cours. Côté
capacités, une intervention de ce type nécessite, selon le ministère de la Défense, de mobiliser environ 15.000 hommes des forces terrestres, les forces spéciales, jusqu’à 45 avions de chasse
(incluant l’aéronautique navale), le porte-avions, deux BPC, un SNA, des frégates, des avions de patrouille maritime, ainsi que les moyens permettant d’assurer les fonctions de commandement,
de renseignement et de logistique (transport, santé, essence, munitions, stocks de rechanges). Le contrat opérationnel pour les opérations majeures est donc, dans ce projet de loi,
significativement réduit par rapport à la précédente LPM. Celle-ci prévoyait, en six mois, que l’armée puisse mobiliser jusqu’à 30.000 hommes, 70 avions de combat, ainsi qu’une force
aéronavale et amphibie constituée de deux à trois groupes d’intervention. Cela pour une durée d’un an.
![Bâtiment de projection et de commandement (© : MARINE NATIONALE) Bâtiment de projection et de commandement (© : MARINE NATIONALE)]()
Bâtiment de projection et de commandement (© : MARINE NATIONALE)
Les moyens de la marine en 2020
Concernant la Marine nationale, ses principales missions demeurent la dissuasion, la protection de l’espace maritime français et des
approvisionnements du pays, l’intervention à l’étranger en cas de crise et l’action de l’Etat en mer. Pour se faire, le projet de LPM prévoit, en 2020, une composante sous-marine forte de 4
SNLE du type Le Triomphant, ainsi que 6 SNA (5 Rubis et 1 Barracuda). La flotte de surface comprendrait, pour sa part, le porte-avions Charles de Gaulle, 3 BPC, 4 frégates de défense aérienne
(2 Horizon et 2 F70 AA), 5 frégates multi-missions (FREMM), les 2 dernières frégates anti-sous-marine du type F70 ASM, 5 frégates du type La Fayette (appelées de nouveau Frégates Légères
Furtives – FLF), 6 frégates de surveillance du type Floréal, ainsi que 10 chasseurs de mines tripartites (CMT) et 4 bâtiments de ravitaillement d’ancienne génération, dont un en réserve. S’y
ajouteraient les 3 nouveaux bâtiments multi-missions (B2M), 7 avisos, 6 patrouilleurs d’ancienne génération, 2 nouveaux patrouilleurs destinés à la Guyane (PLG), ainsi que 8 nouveaux bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers (BSAH).
L’aéronautique navale armerait, pour sa part, 40 avions de combat Rafale Marine, 3 avions de guet aérien Hawkeye, 18 avions de patrouille
maritime Atlantique 2 (dont 4 rénovés), 16 avions de surveillance maritime (7 Falcon 50, 5 Falcon 200 et 4 Atlantique 2 non rénovés), 24 hélicoptères Caïman Marine (NH90 NFH) et 40
hélicoptères légers (Panther, Dauphin, Alouette III).
![Rafale Marine sur le Charles de Gaulle (© : MARINE NATIONALE) Rafale Marine sur le Charles de Gaulle (© : MARINE NATIONALE)]()
Rafale Marine sur le Charles de Gaulle (© : MARINE NATIONALE)
Des renouvellements retardés et des programmes amputés
En termes de cibles, selon le projet de LPM, le nombre de FREMM est maintenu à 11, dont deux en version antiaérienne, mais le programme sera
étalé dans le temps. Seules 6 de ces frégates auront été livrées en 2019, contre 8 prévues jusqu’ici. Alors qu’il ne restera selon le projet que 2 F70 ASM en 2020, la marine devra donc
compter avec un déficit de 2 frégates en attendant l’arrivée de ses dernières FREMM au cours de la première moitié de la prochaine décennie (voir notre article sur l'évolution du programme FREMM).
Le projet de LPM entérine, par ailleurs, la suppression du quatrième BPC, signifiant le non remplacement du transport de chalands de
débarquement Siroco, que la France cherche à vendre (probablement au Chili, qui a déjà acquis la Foudre en 2011). Le programme FLOTLOG, portant sur le renouvellement des vieux ravitailleurs,
qui navigueront toujours en 2020, est quant à lui retardé, aucune livraison n’étant prévue sur la prochaine LPM. Il sera, de plus, réduit de quatre à trois bâtiments seulement (voir notre article détaillé sur FLOTLOG).
![Le design Brave, proposé par DCNS et STX France dans la cadre de FLOTLOG (© : DCNS) Le design Brave, proposé par DCNS et STX France dans la cadre de FLOTLOG (© : DCNS)]()
Le design Brave, proposé par DCNS et STX France dans la cadre de FLOTLOG (© : DCNS)
Par ailleurs, la modernisation des FLF (avec ajout d’un sonar notamment) doit débuter d’ici 2019, alors que les études de la nouvelle frégate de
taille intermédiaire (FTI) seront lancées. Sans surprise, il n’est pas fait mention d’un second porte-avions, mais la modernisation à mi-vie du Charles de Gaulle, vers 2016/2017 est
programmée.
Dans le domaine des patrouilleurs, la situation va demeurer délicate, malgré la mise en service des 3 B2M (le quatrième, qui devait faire
l’objet d’une option, étant donc officiellement abandonné) et des 2 PLG. Faute de crédits, le programme des bâtiments de surveillance et d’intervention maritime (BATSIMAR) est reporté à la
LPM suivante (2020 – 2025). La marine va donc être contrainte de maintenir en activité, autant que possible, ses vieux avisos et patrouilleurs, certains atteignant alors les 40 ans de service
au lieu de 25. Il n’est d’ailleurs pas certain que tous ces bateaux pourront durer aussi longtemps, ce qui augmente le risque, déjà existant avec des effectifs réduits, de ne plus être en
mesure d’assurer certaines missions.
Les chasseurs de mines vont eux aussi devoir jouer les prolongations, le programme SLAMF étant certes lancé d’ici 2019 (voir notre article sur SLAMF), mais les premières livraisons de ce nouveau
système basé sur des drones n’interviendront qu’après 2020. On notera à ce sujet que le projet de LPM évoque 10 CTM en flotte en 2020, contre 11 aujourd’hui.
Pour ce qui est des sous-marins, le programme de refonte des trois premiers SNLE du type Le Triomphant avec le M51 sera achevé, alors que le
nouveau missile balistique sera modernisé, d’abord dans sa version M51.2, puis dans sa version M51.3 dont les études seront lancées au cours de la LPM. Le développement de la troisième
génération de SNLE, prévue pour entrer en service en 2030, montera pour sa part en puissance (voir notre article sur la modernisation de la dissuasion). La cible de 6 SNA du type Barracuda
est maintenue, mais le programme va lui-aussi être retardé (voir notre article à ce
sujet). Seule la tête de série (Suffren) aura été livrée en 2019, la réception par la marine de son premier sistership, prévue initialement à cette date, étant repoussée d’au moins un an
(si ce n’est deux puisqu’il n’apparait pas dans l’inventaire de 2020).
![SNLE du type Le Triomphant SNLE du type Le Triomphant]()
SNLE du type Le Triomphant (© : MARINE NATIONALE)
L’aéronautique navale, enfin, va voir ses moyens réduits significativement dans le domaine des voilures fixes. Seuls 40 Rafale Marine sont
désormais prévus, au lieu de 58 jusqu’ici, la modernisation des Atlantique 2 ne concernant que 15 appareils sur les 27 actuellement en parc. Une partie de ceux-ci sera affectée à de simples
missions de surveillance maritime, permettant de compenser le retard pris par le programme des avions de surveillance et d’intervention maritime (AVISMAR) destiné à remplacer les Falcon 50 et
Falcon 200 (Gardian). Le lancement de ce programme est prévu à la fin de la LPM mais les livraisons n’interviendront qu’après 2020. Il s’agit d’un autre point délicat pour la marine, surtout
au niveau des Gardian (basés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie) qui arrivent en fin de vie et dont le maintien jusqu’à l’arrivée des AVSIMAR n’est pas gagné.
Du côté des hélicoptères, le projet de LPM valide les 27 NH90 de la marine (avec des livraisons conformes aux prévisions) mais n’évoque pas le
remplacement des hélicoptères légers (Alouette III, Dauphin et Panther), qui doit faire l’objet d’un programme interarmées visant également à assurer la succession de machines comme la
Gazelle et le Fennec (voir notre article complet sur les conséquences
du projet de LPM sur l'aéronautique navale).
![(© : MARINE NATIONALE) (© : MARINE NATIONALE)]()
Caïman Marine (© : EUROCOPTER)
L’essentiel sauvegardé
Malgré un format resserré, la flotte et l’aviation navale devraient donc sauvegarder l’essentiel, c'est-à-dire toutes leurs capacités, même si
dans certains cas ce sera avec des effectifs limités, voire très limités. L'Etat aurait pu décider, comme certains le proposaient, d'en sacrifier quelques unes pour renforcer les autres, mais
cela aurait constitué un pari risqué sur l'avenir. Mieux vaut, en effet, conserver le savoir-faire opérationnel et technologique sur l'ensemble du spectre car c'est le seul moyen de
disposer d'une base solide pour redévelopper facilement des capacités lorsque les conditions économiques sont meilleures ou que l'évolution du contexte stratégique l'impose. On notera, de
plus, que la réduction en quantité est dans certains cas largement compensée par la qualité et la polyvalence des nouveaux matériels. Un Rafale Marine est, ainsi, bien plus performant
qu’un Super Etendard Modernisé, tout comme un BPC par rapport à un TCD ou une FREMM visà vis d'une F70. De nouvelles capacités verront aussi le jour, comme la mise en service du missile de
croisière naval lancé à partir des FREMM et des Barracuda, élargissant le panel d’outils des marins au service du pouvoir exécutif. Il est néanmoins clair que le retard pris dans le
renouvellement de certains équipements ne sera pas sans poser des problèmes, les matériels vieillissants étant toujours difficiles et coûteux à entretenir. Sans compter qu’il y a des limites
techniques au-delà desquelles on ne peut aller. De ces contraintes découleront peut être la nécessité de faire des choix dans les missions si la marine ne compte pas assez de plateformes
opérationnelles.
Concernant l’entrainement, autre aspect crucial, Jean-Yves Le Drian assure que l’accent sera mis sur la préparation opérationnelle des forces
armées, qui doit voir ses crédits légèrement augmenter au cours de la LPM.
![Caïman Marine (© : EUROCOPTER) Caïman Marine (© : EUROCOPTER)]()
Frégates du type F70 AA et La Fayette (© : MARINE NATIONALE)
L’enjeu crucial de la recherche et du développement
Pour finir, on notera que le ministère de la Défense, en cette période de crise, marque sa volonté de maintenir l’effort en matière de recherche
et de développement. Il s’agit là d’un point fondamental car la capacité d’une armée tient non seulement à la valeur des hommes, mais aussi à la qualité du matériel, la technologie, qui
évolue rapidement et nécessite des investissements constants, étant à même de faire la différence face à un adversaire numériquement plus important. La France, qui est l’un des rares
pays à disposer d’une industrie de pointe dans tous les domaines militaires stratégiques (aéronautique, missiles, bâtiments de surface et sous-marins, armement terrestre,
renseignement/surveillance, communications/réseaux) se doit à tout prix de préserver et développer ces capacités afin de conserver une industrie de premier plan (qui compte 4000 entreprise et
représente 165.000 emplois directs), à même d’équiper ses forces armées des meilleurs outils, cela en toute autonomie. A cet effet, Jean-Yves Le Drian a annoncé son intention de
« sanctuariser » les crédits alloués aux plans d’études amont (PEA), avec en moyenne 730 millions d’euros par an prévus sur la période 2014 – 2019. Ces investissements
serviront notamment à financer la recherche dans le domaine du nucléaire (dont le SNLE 3G et le M51.3), de l’espace, de la lutte sous la mer, du renseignement, ou encore de la cyber-défense
(un secteur clé pour assurer la sécurité des réseaux informatiques face aux attaques extérieures ou intérieures). Pour l’aéronautique, par exemple, environ 1 milliard d’euros sera consacré à
la modernisation du Rafale (standard F3-R) qui sera doté de nouvelles équipements (missile air-air à longue portée, pod de désignation laser de nouvelle génération). Le projet de LPM prévoit
aussi 700 millions d’euros pour développer avec les Britanniques un drone de combat devant être opérationnel à l’horizon 2030. Un UCAV qui pourrait non seulement équiper les forces aériennes,
mais également le groupe aérien embarqué s’il est dès le début conçu pour pouvoir être navalisé. Une perspective particulièrement intéressante pour compléter dans une quinzaine d'années le
parc de Rafale Marine.
![Frégates du type F70 AA et La Fayette (© : MARINE NATIONALE) Frégates du type F70 AA et La Fayette (© : MARINE NATIONALE)]()
Rafale Marine survolant le Charles de Gaulle (© : ALEXANDRE PARINGAUX)
Source:Marine nationale
Projet de LPM : Un moindre mal
05/08/2013
 De l'Egypteà la France...
De l'Egypteà la France...
 Groupir, restez groupir!!
Groupir, restez groupir!!
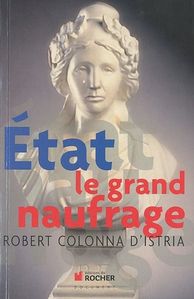












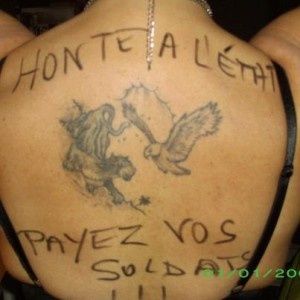
 En Hollandie la Légion à H1coup au second je m'en vais!
En Hollandie la Légion à H1coup au second je m'en vais! Oui c'est bien lui le H Normal de la Rose
Oui c'est bien lui le H Normal de la Rose





































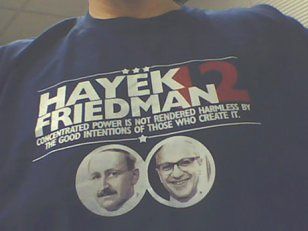




 Daniel Stedman Jones, Masters of the Universe. Hayek,
Friedman, and the birth of neoliberal politics. Princeton University Press, 2012, 424 p.
Daniel Stedman Jones, Masters of the Universe. Hayek,
Friedman, and the birth of neoliberal politics. Princeton University Press, 2012, 424 p.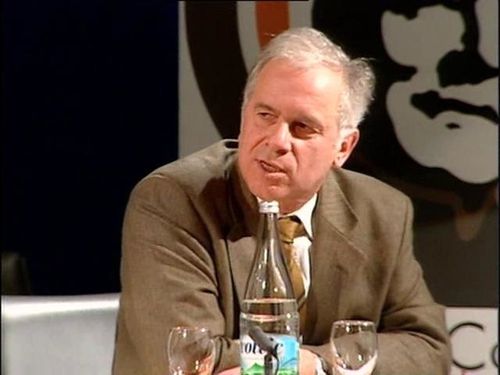


 Le groupe aéronaval
Le groupe aéronaval