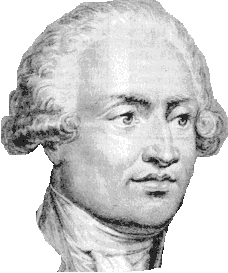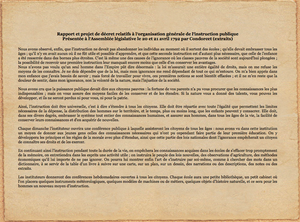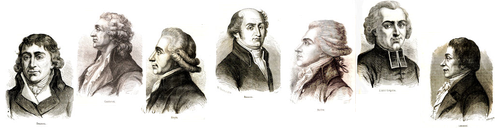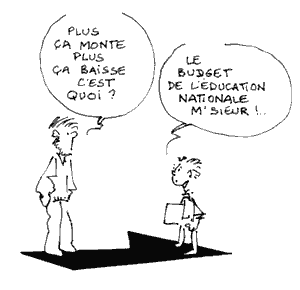L'Ancien Régime disposait de 22 universités et de plusieurs centaines de collèges qui dépendaient des congrégations religieuses (surtout des jésuites avant leur
expulsion, et des Oratoriens) ou de l'université. De petites écoles, nombreuses, apprenaient aux enfants à lire, écrire et compter. Cependant l'obligation scolaire n'était qu'en partie respectée.
A la veille de la Révolution, 71% des hommes et 44% des femmes savaient signer leur nom dans la moitié Nord de la France, et seulement 27% des hommes et 12% des femmes dans le sud. En outre il
existait de grandes disparités entre les villes et les campagnes et la signature n'est pas un signe décisif de la maîtrise de la lecture. Les principes de la Révolution étaient hostiles à
l'enseignement des congrégations. La Législative créa donc un comité d'instruction publique pour proposer un projet d'éducation nationale. Condorcet en fut le rédacteur et proposa dans un exposé
didactique et un peu froid une organisation de l'école, des enseignements et des principes d'une grande modernité. Son rapport, très applaudi, est long et d'une grande précision. On en trouvera
ici les arguments et les dispositions. On en retiendra au moins l'affirmation du caractère universel et gratuit de l'enseignement élémentaire. Mais il faudra attendre le 19 décembre 1793 pour que
la Convention adopte la loi rendant l'instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants de six à huit ans. Condorcet, mais aussi Grégoire et Lindet auront apporté leur efficace concours à
cette décision qui, malgré son importance, avait été longtemps renvoyée au second plan par des problèmes plus urgents.
![AVT2_Marie-Jean-Antoine-de-Caritat-Condorcet_3038.gif]()
Voici l'exposé:
Rapport et projet de décret
relatifs à l'organisation générale de l'instruction publique
Présentation à l'Assemblée législative : 20 et 21 avril 1792
" Messieurs,
Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs
droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs ; Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être
appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi .
Tel doit être le premier but d'une instruction nationale ; et, sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Diriger l'enseignement de manière que la perfection
des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent ; qu'un plus grand nombre d'hommes deviennent capables de bien remplir les fonctions
nécessaires à la société, et que les progrès toujours croissants des lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens de bonheur individuel
et de prospérité commune ; cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques, intellectuelles et morales, et, par là, contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l'espèce
humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée : tel doit être l'objet de l'instruction ; et c'est pour la puissance publique un devoir imposé par l'intérêt commun
de la société, par celui de l'humanité entière.
Mais en considérant sous ce double point de vue la tâche immense qui nous a été imposée, nous avons senti, dès nos premiers pas, qu'il existait une
portion du système général de l'instruction qu'il était possible d'en détacher, sans nuire à l'ensemble, et qu'il était nécessaire d'en séparer, pour accélérer la réalisation du nouveau système :
c'est la distribution et l'organisation générale des établissements d'enseignement public.
En effet, quelles que soient les opinions sur l'étendue précise de chaque degré d'instruction ; sur la manière d'enseigner ; sur le plus ou moins
d'autorité conservée aux parents ou cédée aux maîtres ; sur la réunion des élèves dans des pensionnats établis par l'autorité publique ; sur les moyens d'unir à l'instruction proprement dite le
développements des facultés physiques et morales, l'organisation peut être la même ; et, d'un autre côté, la nécessité de désigner les lieux d'établissements, de faire composer les livres
élémentaires, longtemps avant que ces établissements puissent être mis en activité, obligeaient à préciser la décision de la loi sur cette portion du travail qui nous est confié.
Nous avons pensé que, dans ce plan d'organisation générale, notre premier soin devait être de rendre, d'un côté, l'éducation aussi égale, aussi
universelle ; de l'autre, aussi complète que les circonstances pouvaient le permettre, qu'il fallait donner à tous également l'instruction qu'il est possible d'étendre sur tous ; mais ne refuser
à aucune portion de citoyens l'instruction plus élevée, qu'il est impossible de faire partager à la masse entière des individus ; établir l'une, parce qu'elle est utile à ceux qui la reçoivent ;
et l'autre, parce qu'elle l'est à ceux même qui ne la reçoivent pas. La première condition de toute instruction étant de n'enseigner que des vérités, les établissements que la puissance publique
y consacre doivent être aussi indépendants qu'il est possible de toute autorité politique ; et comme, néanmoins, cette indépendance ne peut être absolue, il résulte du même principe, qu'il faut
ne les rendre dépendants que de l'Assemblée des représentants du peuple, parce que, de tous les pouvoirs, il est le moins corruptible, le plus éloigné d'être entraîné par des intérêts
particuliers, le plus soumis à l'influence de l'opinion générale des hommes éclairés, et surtout parce qu'étant celui de qui émanent essentiellement tous les changements, il est dès lors le moins
ennemi du progrès des lumières, le moins opposé aux améliorations que ce progrès doit amener. Nous avons observé, enfin, que l'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où il
sortent des écoles ; qu'elle devait embrasser tous les âges ; qu'il n'y en avait aucun où il ne fût utile et possible d'apprendre, et que cette seconde instruction est d'autant plus nécessaire,
que celle de l'enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. C'est là même une des causes de l'ignorance où les classes pauvres de la société sont aujourd'hui plongées.; la possibilité
de recevoir une première instruction leur manquait encore moins que celle d'en conserver les avantages.
Nous n'avons pas voulu qu'un seul homme dans l'Empire pût dire désormais : la loi m'assurait une entière égalité de droits, mais on me refuse les
moyens de les connaître. Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon ignorance me rend dépendant de tout ce qui m'entoure. On m'a bien appris dans mon enfance que j'avais besoin de savoir ; mais
forcé de travailler pour vivre, ces premières notions se sont bientôt effacées ; et il ne m'en reste que la douleur de sentir, dans mon ignorance, non la volonté de la nature, mais l'injustice de
la société.
Nous avons cru que la puissance publique devait dire aux citoyens pauvres : la fortune de vos parents n'a pu vous procurer que les connaissances les
plus indispensables ; mais on vous assure des moyens faciles de les conserver et de les étendre. Si la nature vous a donné des talents, vous pouvez les développer, et ils ne seront perdus ni pour
vous, ni pour la patrie.
Ainsi, l'instruction doit être universelle, c'est à dire s'étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l'égalité que permettent
les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire, et le temps, plus ou moins long, que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés,
embrasser le système tout entier des connaissances humaines, et assurer aux hommes, dans tous les âges de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances et d'en acquérir de
nouvelles.
Enfin, aucun pouvoir public ne doit avoir l'autorité ni même le crédit, d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l'enseignement des
théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. Tels ont été les principes qui nous ont guidés dans notre travail.
Nous avons distingué cinq degrés d'instruction sous le nom : 1° d'écoles primaires, 2° d'écoles secondaires, 3° d'instituts, 4° de lycées, 5° de
société nationale des sciences et des arts.
On enseigne dans les écoles primaires ce qui est nécessaire à chaque individu pour se conduire lui-même et jouir de la plénitude de ses droits.
Cette instruction suffira même à ceux qui profiteront des leçons destinées aux hommes pour les rendre capables des fonctions publiques les plus simples, auxquelles il est bon que tout citoyen
puisse être appelé, comme celle de juré, d'officier municipal. Toute collection de maisons renfermant quatre cents habitants aura une école et un maître.
Comme il ne serait pas juste que dans les départements où les habitations sont dispersées ou réunies par groupes plus petits, le peuple n'obtînt pas
des avantages égaux, on placera une école primaire dans tous les arrondissements où se trouveront des villages éloignés de plus de mille toises, d'un endroit qui renferme quatre cents habitants.
On enseignera dans ces écoles, à lire, à écrire, ce qui suppose nécessairement quelques notions grammaticales; on y joindra les règles de l'arithmétique, des méthodes simples de mesurer
exactement un terrain, de toiser un édifice, une description élémentaire des productions du pays, des procédés de l'agriculture et des arts, le développement des premières idées morales et des
règles de conduite qui en dérivent, enfin ceux des principes de l'ordre social qu'on peut mettre à la portée de l'enfance.
Ces diverses instructions seront distribuées en quatre cours dont chacun doit occuper une année les enfants d'une capacité commune. Ce terme de
quatre ans qui permet une division commode, pour une école où l'on ne peut placer qu'un seul maître, répond aussi assez exactement à l'espace de temps qui, pour les enfants des familles les plus
pauvres, s'écoule entre l'époque où ils commencent à être capables d'apprendre, et celle où ils peuvent être employés à un travail utile, assujettis à un apprentissage régulier.
Chaque dimanche l'instituteur ouvrira une conférence publique à laquelle assisteront les citoyens de tous les âges : nous avons vu dans cette
institution un moyen de donner aux jeunes gens celles des connaissances nécessaires qui n'ont pu cependant faire partie de leur première éducation. On y développera les principes et les règles de
la morale avec plus d'étendue, ainsi que cette partie des lois nationales dont l'ignorance empêcherait un citoyen de connaître ses droits et de les exercer.
Ainsi, dans ces écoles les vérités premières de la science sociale précèderont leurs applications. Ni la Constitution française ni même la
Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens, comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire. Leur enthousiasme ne sera point fondé sur les préjugés,
sur les habitudes de l'enfance ; et on pourra leur dire : « Cette Déclaration des droits qui vous apprend à la fois ce que vous devez à la société et ce que vous êtes en droit d'exiger d'elle,
cette Constitution que vous devez maintenir aux dépens de votre vie ne sont que le développement de ces principes simples, dictés par la nature et par la raison dont vous avez appris, dans vos
premières années, à reconnaître l'éternelle vérité. Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les
chaînes auront été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d'utiles vérités ; le genre humain n'en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle
des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves.» (Applaudissements, plusieurs membres réclament l'exécution du décret rendu dans cette séance relativement aux
applaudissements.)
![RapportCondorcet.png]()
M. Ducos : L'Assemblée a entendu défendre
seulement d'applaudir les personnes et non pas les choses.
M. de Condorcet : En continuant ainsi
l'instruction pendant toute la durée de la vie, on empêchera les connaissances acquises dans les écoles de s'effacer trop promptement de la mémoire, on entretiendra dans les esprits une activité
utile ; on instruira le peuple des lois nouvelles, des observations d'agriculture, des méthodes économiques qu'il lui importe de ne pas ignorer. On pourra lui montrer enfin l'art de s'instruire
par soi-même, comme à chercher des mots dans un dictionnaire, à se servir de la table d'un livre à suivre sur une carte, sur un plan, sur un dessin, des narrations ou des descriptions, des notes
ou des extraits. Ces moyens d'apprendre, que dans une éducation plus étendue on acquiert par la seule habitude, doivent être directement enseignés dans une instruction bornée à un temps plus
court, et à un petit nombre de leçons.
Nous n'avons ici parlé, soit pour les enfants, soit pour les hommes, que de l'enseignement direct, parce que c'est le seul dont il soit nécessaire
de connaître la marche, la distribution, l'étendue, avant de déterminer l'organisation des établissements d'instruction publique. D'autres moyens seront l'objet d'une autre partie de notre
travail. Ainsi, par exemple, les fêtes nationales, en rappelant aux habitants des campagnes, aux citoyens des villes, les époques glorieuses de la liberté, en consacrant la mémoire des hommes
dont les vertus ont honoré leur séjour, en célébrant les actions de dévouement ou de courage dont il a été le théâtre, leur apprendront à chérir les devoirs qu'on leur aura fait connaître. D'un
autre côté, dans la discipline intérieure des écoles, on prendra soin d'instruire les enfants à être bons et justes ; on leur fera pratiquer, les uns à l'égard des autres, les principes qu'on
leur aura enseignés ; et par là, en même temps qu'on leur fera prendre l'habitude d'y conformer leur conduite, ils apprendront à les mieux entendre, à en sentir plus fortement l'utilité et la
justice.
On fera composer, soit pour les hommes, soit même pour les enfants, des livres faits pour eux, qu'ils pourraient lire sans fatigue, et qu'un
intérêt, soit d'utilité prochaine, soit de plaisir, les engagerait à se procurer. Placez à côté des hommes les plus simples une instruction agréable et facile, surtout une instruction utile, et
ils en profiteront. Ce sont les difficultés rebutantes de la plupart des études, c'est la vanité de celles à qui le préjugé avait fait donner la préférence, qui éloignaient les hommes de
l'instruction.
La gymnastique ne sera point oubliée ; mais on aura soin d'en diriger les exercices de manière à développer toutes les forces avec égalité, à
détruire les effets des habitudes forcées que donnent les diverses de travaux. Si l'on reproche à ce plan de renfermer une instruction trop étendue, nous pourrons répondre qu'avec des livres
élémentaires bien faits et destinés à être mis entre les mains des enfants, avec le soin de donner aux maîtres des ouvrages composés pour eux, où ils puissent s'instruire de la manière de
développer les principes, de se proportionner à l'intelligence des élèves, de leur rendre le travail plus facile, on n'aura point à craindre que l'étendue de cet enseignement excède les bornes de
la capacité ordinaire des enfants. Il existe, d'ailleurs, des moyens de simplifier les méthodes, de mettre les vérités à la portée des esprits les moins exercés ; et c'est d'après la connaissance
de ces moyens, d'après l'expérience, qu'a été tracé le tableau des connaissances élémentaires qu'il était nécessaire de présenter à tous les hommes, qu'il leur était possible d'acquérir.
On pourrait aussi nous reprocher d'avoir, au contraire, trop resserré les limites de l'instruction destinée à la généralité des citoyens ; mais la
nécessité de se contenter d'un seul maître pour chaque établissement, celle de placer les écoles auprès des enfants, le petit nombre d'années que ceux des familles pauvres peuvent donner à
l'étude, nous ont forcés de resserrer cette première instruction dans des bornes étroites ; et il sera facile de les reculer lorsque l'amélioration de l'état du peuple, la distribution plus égale
des fortunes, suite nécessaire des bonnes lois, les progrès des méthodes d'enseignement, en auront amené le moment ; lorsque enfin la diminution de la dette, et celle des dépenses superflues,
permettra de consacrer à des emplois vraiment utiles une plus forte portion des revenus publics.
Les écoles secondaires sont destinées aux enfants dont les familles peuvent se passer plus longtemps de leur travail et consacrer à leur éducation
un plus grand nombre d'années ou même quelques avances. Chaque district, et, de plus, de plus chaque ville de quatre mille habitants aura une de ces écoles secondaires. Une combinaison analogue à
celle dont nous avons parlé pour les écoles primaires assure qu'il n'y aura point d'inégalité dans la distribution de ces établissements. L'enseignement sera le même dans tous ; mais ils auront
un, deux, trois instituteurs suivant le nombre d'élèves qu'on peut supposer devoir s'y rendre.
Quelques notions de mathématiques, d'histoire naturelle et de chimie nécessaires aux arts ; des développements plus étendus des principes de la
morale et de la science sociale ; des leçons élémentaires de commerce y formeront le fond de l'instruction.
Les instituteurs donneront des conférences hebdomadaires ouvertes à tous les citoyens. Chaque école aura une petite bibliothèque, un petit cabinet
où l'on placera quelques instruments météorologiques, quelques modèles de machines ou de métiers, quelques objets d'histoire naturelle, et ce sera pour les hommes un nouveau moyen d'instruction.
Sans doute, ses collections seront d'abord nulles ; mais elles s'accroîtront avec le temps, s'augmenteront par des dons, se compléteront par des échanges ; elles répandront le goût de
l'observation et de l'étude et ce goût contribuera bientôt à leur progrès. Ce degré d'instruction peut encore, à quelques égards, être envisagé comme universel, une égalité plus absolue. Les
cultivateurs, à la vérité, en sont réellement exclus lorsqu'ils ne se trouvent pas assez riches pour déplacer leurs enfants ; mais ceux des campagnes, destinés à des métiers, doivent
naturellement achever leur apprentissage dans les villes voisines, et ils recevront, dans les écoles secondaires, du moins la portion de connaissances qui leur sera le plus nécessaire. D'un autre
côté, les cultivateurs ont dans l'année des temps de repos dont ils peuvent donner une partie à l'instruction, et les artisans sont privés de cette espèce de loisir. Ainsi, l'avantage d'une étude
isolée et volontaire balance, pour les uns, celui qu'ont les autres de recevoir des leçons plus étendues ; et, sous ce point de vue, l'égalité est encore conservée, plutôt que détruite, par
l'établissement des écoles secondaires.
Il y a plus : à mesure que les manufactures se perfectionnent, leurs opérations se divisent de plus en plus, ou tendent sans cesse à ne charger
chaque individu que d'un travail purement mécanique et réduit à un petit nombre de mouvements simples ; travail qu'il exécute mieux et plus promptement, mais par l'effet de la seule habitude, et
dans lequel son esprit cesse presque entièrement d'agir. Ainsi, le perfectionnement des arts deviendrait, pour une partie de l'espèce humaine, une cause de stupidité ; ferait naître dans chaque
nation une classe d'hommes incapables de s'élever au-dessus des plus grossiers intérêts ; y introduirait, et une inégalité humiliante, et une semence de troubles dangereux, si une instruction
plus étendue n'offrait aux individus de cette même classe une ressource contre l'effet infaillible de la monotonie de leurs occupations journalières. L'avantage que les écoles secondaires semble
donner aux villes n'est donc encore qu'un nouveau moyen de rendre l'égalité plus entière.
Les conférences hebdomadaires proposées pour ces deux premiers degrés ne doivent pas être regardées comme un faible moyen d'instruction. Quarante ou
cinquante leçons par année peuvent renfermer une grande étendue de connaissances, dont les plus importantes répétées chaque année, d'autres tous les deux ans, finiront par être entièrement
comprises, retenues, par ne pouvoir plus être oubliées. En même temps, une autre portion de cet enseignement se renouvellera continuellement, parce qu'elle aura pour objet, soit des procédés
nouveaux d'agriculture ou d'arts mécaniques, des observations, des remarques nouvelles, soit l'exposition des lois générales, à mesure qu'elles seront promulguées, le développement des opérations
du gouvernement d'un intérêt universel. Elle soutiendra la curiosité, augmentera l'intérêt de ces leçons, entretiendra l'esprit public et le goût de l'occupation.
Qu'on ne craigne pas que la gravité de ces instructions en écarte le peuple. Pour l'homme occupé de travaux corporels, le repos seul est un plaisir,
et une légère contention d'esprit un véritable délassement : c'est pour lui ce qu'est le mouvement du corps pour le savant livré à des études sédentaires, in moyen de ne pas laisser engourdir
celle des facultés que ses occupations habituelles n'exercent pas assez. L'homme des campagnes, l'artisan des villes, ne dédaignera point des connaissances dont il aura une fois connu les
avantages par son expérience ou celle de ses voisins. Si la seule curiosité l'attire d'abord, bientôt l'intérêt le retiendra. La frivolité, le dégoût des choses sérieuses, le dédain pour ce qui
n'est qu'utile, ne sont pas les vices des hommes pauvres ; et cette prétendue stupidité, née de l'asservissement et de l'humiliation, disparaîtra bientôt, lorsque des hommes libres trouveront
auprès d'eux les moyens de briser la dernière et la plus honteuse de leurs chaînes.
Le troisième degré d'instruction embrasse les éléments de toutes les connaissances humaines. L'instruction, considérée comme partie de l'éducation
générale, y est absolument complète. Elle renferme ce qui est nécessaire pour être en état de se préparer à remplir les fonctions publiques qui exigent le plus de lumières, ou de se livrer avec
succès à des études plus approfondies : c'est là que se formeront les instituteurs des écoles secondaires, que se perfectionneront les maîtres des écoles primaires déjà formés dans celles du
second degré. Le nombre des instituts a été porté à cent dix, et il en sera établi dans chaque département. On y enseignera non seulement ce qu'il est utile de savoir comme homme, comme citoyen,
à quelque profession qu'on se destine ; mais aussi tout ce qui peut l'être pour chaque grande division de ces professions, comme l'agriculture, les arts mécaniques, l'art militaire ; et même on y
a joint les connaissances médicales, nécessaires aux simples praticiens, aux sages-femmes, aux artistes vétérinaires.
En jetant les yeux sur la liste des professeurs, on remarquera peut-être que les objets d'instruction n'y sont pas distribués suivant une division
philosophique, que les sciences physiques et mathématiques y occupent une très grande place, tandis que les connaissances qui dominaient dans l'ancien enseignement y paraissent négligées. Mais
nous avons cru devoir distribuer les sciences d'après les méthodes qu'elles emploient, et par conséquent d'après la réunion de connaissances qui existe le plus ordinairement chez les hommes
instruits, ou qu'il leur est plus facile de compléter. Peut-être une classification philosophique des sciences n'eût été dans l'application qu'embarrassante, et presque impraticable. En effet,
prendrait-on pour base les diverses facultés de l'esprit ? Mais l'étude de chaque science les met toutes en activité, et contribue à les développer, à les perfectionner. Nous les exerçons même
toutes à la fois, presque dans chacune des opérations intellectuelles. Comment attribuerez vous telle partie des connaissances humaines à la mémoire, à l'imagination, à la raison, si lorsque vous
demandez par exemple à un enfant de démontrer sur une planche une proposition de géométrie, il ne peut y parvenir sans employer à la fois sa mémoire, son imagination et sa raison ? Vous mettrez
sans doute la connaissance des faits dans la classe que vous affectez à la mémoire ; vous placerez donc l'histoire naturelle à côté de celle des nations, l'étude des arts auprès de celle des
langues ; vous les séparerez de la chimie, de la politique, de la physique, de l'analyse métaphysique, sciences auxquelles ces connaissances de faits sont liées, et par la nature des choses et
par la méthode même de les traiter. Prendra-t-on pour base la nature des objets ? Mais le même objet, suivant la manière de l'envisager, appartient à des sciences absolument différentes. Ces
sciences ainsi classées exigent des qualités d'esprit qu'une même personne réunit rarement ; il aurait été très difficile de trouver, et peut-être de former des hommes en état de se plier à ces
divisions d'enseignement. Les mêmes sciences ne se rapporteraient pas aux mêmes professions, leurs parties n'inspireraient pas un goût égal aux mêmes esprits, et ces divisions auraient fatigué
les élèves comme les maîtres. Quelque autre base philosophique que l'on choisisse, on se trouvera toujours arrêté par des obstacles du même genre. D'ailleurs, il fallait donner à chaque partie
une certaine étendue, et maintenir entre elles une espèce d'équilibre ; or, dans une division philosophique, on ne pourrait y parvenir qu'en réunissant par l'enseignement ce qu'on aurait séparé
par la classification. Nous avons donc imité dans nos distributions la marche que l'esprit humain a suivie dans ses recherches, sans prétendre l'assujettir à en prendre une autre, d'après celle
que nous donnerions à l'enseignement. Le génie veut être libre, toute servitude le flétrit, et souvent on le voit porter encore, lorsqu'il est dans toute sa force, l'empreinte des fers qu'on lui
avait donnés au moment où son premier germe se développait dans les exercices de l'enfance. Ainsi, puisqu'il faut nécessairement une distribution d'études, nous avons dû préférer celle qui
s'était d'elle-même librement établie, au milieu des progrès rapides que tous les genres de connaissances ont fait depuis un demi-siècle. Plusieurs motifs ont déterminé l'espèce de préférence
accordée aux sciences mathématiques et physiques.
D'abord, pour les hommes qui ne se dévouent point à de longues méditations, qui n'approfondissent aucun genre de connaissances, l'étude même
élémentaire de ces sciences est le moyen le plus sûr de développer leurs facultés intellectuelles, de leur apprendre à raisonner juste, à bien analyser leurs idées. On peut sans doute, en
s'appliquant à la littérature, à la grammaire, à l'histoire, à la politique, à la philosophie en général, acquérir de la justesse, de la méthode, une logique saine et profonde, et cependant
ignorer les sciences naturelles. De grands exemples l'ont prouvé ; mais les connaissances élémentaires dans ces mêmes genres n'ont pas cet avantage ; elles emploient la raison, mais elles ne la
formeraient pas. C'est que dans les sciences naturelles, les idées sont plus simples, plus rigoureusement circonscrites ; c'est que la langue en est plus parfaite, que les mêmes mots y expriment
plus exactement les mêmes idées. Les éléments y sont une véritable partie de la science, resserrée dans d'étroites limites, mais complète en elle-même. Elles offrent encore à la raison un moyen
de s'exercer, à la portée d'un plus grand nombre d'esprits, surtout dans la jeunesse. Il n'est pas d'enfant, s'il n'est absolument stupide, qui ne puisse acquérir quelque habitude d'application,
par des leçons élémentaires d'histoire naturelle ou d'agriculture. Ces sciences sont contre les préjugés, contre la petitesse d'esprit, un remède sinon plus sûr, du moins plus universel que la
philosophie même. Elles sont utiles dans toutes les professions ; et il est aisé de voir combien elles le seraient davantage, si elles étaient plus uniformément répandues. Ceux qui en suivent la
marche voient approcher l'époque où l'utilité pratique de leur application va prendre une étendue à laquelle on n'aurait osé porter ses espérances, où les progrès des sciences physiques doivent
produire une heureuse révolution dans les arts ; et le plus sûr moyen d'accélérer cette révolution, est de répandre ces connaissances dans toutes les classes de la société, de leur faciliter les
moyens de les acquérir.
Enfin, nous avons cédé à l'impulsion générale des esprits, qui en Europe semblent se porter vers ces sciences avec une ardeur toujours croissante.
Nous avons senti que, par une suite des progrès de l'espèce humaine, ces études qui offrent à son activité un aliment éternel, inépuisable, devenaient d'autant plus nécessaires, que le
perfectionnement de l'ordre social doit offrir moins d'objets à l'ambition ou à l'avidité ; que dans un pays où l'on voulait unir enfin par des noeuds immortels la paix et la liberté, il fallait
que l'on pût sans ennui, sans s'éteindre dans l'oisiveté, consentir à n'être qu'un homme et un citoyen ; qu'il était important de tourner vers des objets utiles ce besoin d'agir, cette soif de
gloire, à laquelle l'état d'une société bien gouvernée n'offre pas un champ assez vaste ; et de substituer enfin l'ambition d'éclairer les hommes à celle de les dominer.
Dans la partie de l'ancien enseignement qui répond à ce troisième degré d'instruction, on se bornait à un petit nombre d'objets : nous devons les
embrasser tous. On semblait n'avoir voulu faire que des théologiens ou des prédicateurs : nous aspirons à former des hommes éclairés. L'ancien enseignement n'en était pas moins vicieux par sa
forme que par le choix et la distribution des objets. Pendant six années, une étude progressive du latin faisait le fond de l'instruction ; et c'était sur ce fond qu'on répandait les principes
généraux de la grammaire, quelques connaissances de géographie et d'histoire, quelques notions de l'art de parler et d'écrire. Quatre professeurs sont ici destinés à remplir les mêmes indications
; mais les objets des études sont séparés, mais chaque maître enseigne une seule connaissance ; et cette disposition plus favorable aux progrès des élèves, fera plus que compenser la diminution
du nombre des maîtres. On pourra encore trouver la langue latine trop négligée. Mais sous quel point de vue une langue doit-elle être considérée dans une éducation générale ? Ne suffit-il pas de
mettre les élèves en état de lire les livres vraiment utiles écrits dans cette langue, et de pouvoir, sans maîtres, faire de nouveaux progrès ? Peut-on regarder la connaissance approfondie d'un
idiome étranger, celle des beautés de style qu'offrent les ouvrages des hommes de génie qui l'ont employé, comme une de ces connaissances générales que tout homme éclairé, tout citoyen qui se
destine aux emplois de la société les plus importants, ne puisse ignorer ? Par quel privilège singulier, lorsque le temps destiné pour l'instruction, lorsque l'objet même de l'enseignement force
de se borner dans tous les genres à des connaissances élémentaires, et de laisser ensuite le goût des jeunes gens se porter librement vers celles qu'ils veulent cultiver, le latin seul serait-il
l'objet d'une instruction plus étendue ? Le considère-t-on comme la langue générale des savants, quoiqu'il perde tous les jours cet avantage ? Mais une connaissance élémentaire du latin suffit
pour lire leurs livres ; mais il ne se trouve aucun ouvrage de science, de philosophie, de politique vraiment important, qui n'ait été traduit ; mais toutes les vérités que renferment ces livres
existent, et mieux développées, et réunies à des vérités nouvelles, dans des livres écrits en langue vulgaire. La lecture des originaux n'est proprement utile qu'à ceux dont l'objet n'est pas
l'étude de la science même, mais celle de son histoire. Enfin, puisqu'il faut tout dire, puisque tous les préjugés doivent aujourd'hui disparaître, l'étude longue, approfondie des langues des
anciens, étude qui nécessiterait la lecture des livres qu'ils nous ont laissés, serait peut-être plus nuisible qu'utile. Nous cherchons dans l'éducation à faire connaître des vérités, et ces
livres sont remplis d'erreurs. Nous cherchons à former la raison, et ces livres peuvent l'égarer. Nous sommes si éloignés des anciens, nous les avons tellement devancés dans la route de la
vérité, qu'il faut avoir sa raison déjà tout armée, pour que ces précieuses dépouilles puissent l'enrichir sans la corrompre. Comme modèles dans l'art d'écrire, dans l'éloquence, dans la poésie,
les anciens ne peuvent même servir qu'aux esprits déjà fortifiés par des études premières. Qu'est-ce, en effet, que des modèles qu'on ne peut imiter sans examiner sans cesse ce que la différence
des moeurs, des langues, des religions, des idées, oblige d'y changer ? Je n'en citerai qu'un exemple. Démosthène, à la tribune, parlait aux Athéniens assemblés ; le décret que son discours avait
obtenu était rendu par la nation même, et les copies de l'ouvrage circulaient ensuite lentement parmi les orateurs ou leurs élèves. Ici nous prononçons un discours non devant le peuple, mais
devant ses représentants ; et ce discours, répandu par l'impression, a bientôt autant de juges froids et sévères qu'il existe en France de citoyens occupés de la chose publique. Si une éloquence
entraînante, passionnée, séductrice, peut égarer quelquefois les assemblées populaires, ceux qu'elle trompe n'ont à prononcer que sur leurs propres intérêts ; leurs fautes ne retombent que sur
eux-mêmes. Mais des représentants du peuple, qui, séduits par un orateur, céderaient à une autre force qu'à celle de la raison, trahiraient leur devoir, puisqu'ils prononcent sur les intérêts
d'autrui, et perdraient bientôt la confiance publique, sur laquelle seule toute constitution représentative est appuyée. Ainsi, cette même éloquence, nécessaire aux constitutions anciennes,
serait, dans la nôtre, le germe d'une corruption destructrice. Il était alors permis, utile peut-être, d'émouvoir le peuple. Nous lui devons de ne chercher qu'à l'éclairer. Pesez toute
l'influence que ce changement dans la forme des constitutions, toute celle que l'invention de l'imprimerie peuvent avoir sur les règles de l'art de parler, et prononcez ensuite si c'est aux
premières années de la jeunesse que les orateurs anciens doivent être donnés pour modèles. Vous devez à la nation française une instruction au niveau de l'esprit du dix-huitième siècle, de cette
philosophie qui, en éclairant la génération contemporaine, présage, prépare et devance déjà la raison supérieure à laquelle les progrès nécessaires du genre humain appellent les générations
futures.
Tels ont été nos principes ; et c'est d'après cette philosophie, libre de toutes les chaînes, affranchie de toute autorité, de toute habitude
ancienne, que nous avons choisi et classé les objets de l'instruction publique. C'est d'après cette même philosophie que nous avons regardé les sciences morales et politiques comme une partie
essentielle de l'instruction commune. Comment espérer, en effet, d'élever jamais la morale du peuple, si l'on ne donne pour base à celle des hommes qui peuvent l'éclairer, qui sont destinés à
diriger, une analyse exacte, rigoureuse des sentiments moraux, des idées qui en résultent, des principes de justice qui en sont la conséquence ? Les bonnes lois, disait Platon, sont celles que
les citoyens aiment plus que la vie. En effet, comment les lois seraient-elles bonnes, si, pour les faire exécuter, il fallait employer une force étrangère à celle du peuple, et prêter à la
justice l'appui de la tyrannie ? Mais pour que les citoyens aiment les lois sans cesser d'être vraiment libres, pour qu'ils conservent cette indépendance de la raison, sans laquelle l'ardeur pour
la liberté n'est qu'une passion et non une vertu, il faut qu'ils connaissent ces principes de la justice naturelle, ces droits essentiels de l'homme, dont les lois ne sont que le développement ou
les applications. Il faut savoir distinguer dans les lois les conséquences de ces droits et les moyens plus ou moins heureusement combinés pour en assurer la garantie ; aimer les unes parce que
la justice les a dictées ; les autres, parce qu'elles ont été inspirées par la sagesse. Il faut savoir distinguer ce dévouement de la raison qu'on doit aux lois qu'elle approuve, de cette
soumission, de cet appui extérieur que le citoyen leur doit encore, lors même que ses lumières lui en montrent le danger ou l'imperfection. Il faut qu'en aimant les lois, on sache les juger.
Jamais un peuple ne jouira d'une liberté constante, assurée, si l'instruction dans les sciences politiques n'est pas générale, si elle n'y est pas indépendante de toutes les institutions
sociales, si l'enthousiasme que vous excitez dans l'âme des citoyens n'est pas dirigé par la raison, s'il peut s'allumer pour ce qui ne serait pas la vérité, si en attachant l'homme par
l'habitude, par l'imagination, par le sentiment à sa constitution, à ses lois, à sa liberté, vous ne lui préparez, par une instruction générale, les moyens de parvenir à une constitution plus
parfaite, de se donner de meilleures lois, et d'atteindre à une liberté plus entière. Car il en est de la liberté, de l'égalité, de ces grands objets des méditations politiques, comme de ceux des
autres sciences, il existe dans l'ordre des choses possibles un dernier terme dont la nature a voulu que nous puissions approcher sans cesse, mais auquel il nous est refusé de pouvoir atteindre
jamais.
Ce troisième degré d'instruction donne à ceux qui en profiteront une supériorité réelle que la distribution des fonctions de la société rend
inévitable ; mais c'est un motif de plus pour vouloir que cette supériorité soit celle de la raison et des véritables lumières pour chercher à former des hommes instruits, et non des hommes
habiles ; pour ne pas oublier enfin que les inconvénients de cette supériorité deviennent moindres à mesure qu'elle se partage entre un plus grand nombre d'individus ; que plus ceux qui en
jouissent sont éclairés, moins elle est dangereuse et qu'alors elle est le véritable, l'unique remède contre cette supériorité d'adresse qui, au lieu de donner à l'ignorance des appuis et des
guides, n'est féconde qu'en moyens de la séduire.
L'enseignement sera partagé par cours, les uns liés entre eux, les autres séparés, quoique faits par le même professeur. La distribution en sera
telle, qu'un élève pourra suivre à la fois quatre cours, ou n'en suivre qu'un seul ; embrasser, dans l'espace de cinq ans environ, la totalité de l'instruction, s'il a une grande facilité ; se
borner à une seule partie dans le même espace de temps, s'il a des dispositions moins heureuses. On pourra même, pour chaque science, s'arrêter à tel ou tel terme, y consacrer plus ou moins de
temps ; en sorte que ces diverses combinaisons se prêtent à toute les variations de talents, à toutes les positions personnelles. Les professeurs tiendront une fois par mois des conférences
publiques. Comme elles sont destinées à des hommes déjà plus instruits, plus en état d'acquérir des lumières par eux-mêmes, il est moins nécessaire de les multiplier. Elles auront pour objet
principal les découvertes dans les sciences, les expériences, les observations nouvelles, les procédés utiles aux arts ; et, par nouveau, l'on entend ici ce qui, sans sortir des limites
d'une instruction élémentaire, n'est pas encore placé au rang des connaissances communes, des procédés généralement adoptés. Auprès de chaque collège on trouvera une bibliothèque, un cabinet, un
jardin de botanique,un jardin d'agriculture. Ces établissements seront confiés à un conservateur ; et l'on sent que des hommes qui ne sont pas sans quelques lumières, peuvent apprendre beaucoup,
en profitant de ces collections et des éclaircissements que le conservateur, que les professeurs ne leur refuseront pas.
Enfin, comme dans ce degré d'instruction il ne faut pas se borner à de simples explications, qu'il faut encore exercer les élèves, soit à des
démonstrations, à des discussions, soit même à quelques compositions ; qu'il est nécessaire de s'assurer s'ils entendent, s'ils retiennent ; si leurs facultés intellectuelles acquièrent de
l'activité et de la force ; on pourra réserver dans chaque salle une place destinée à ceux qui, sans être élèves, sans être, par conséquent, assujettis aux questions qu'on leur fait, aux travaux
qu'on leur impose, voudraient suivre un cours d'instruction, ou assister à quelques leçons. Cette espèce de publicité, réglée de manière qu'elle ne puisse troubler l'ordre de l'enseignement,
aurait trois avantages : le premier, de procurer des moyens de s'éclairer, à ceux des citoyens qui n'ont pu recevoir une instruction complète, ou qui n'en ont pas assez profité ; de leur offrir
la faculté d'acquérir à tous les âges les connaissances qui peuvent leur devenir utiles, de faire en sorte que le bien immédiat qui peut résulter du progrès des sciences ne soit pas exclusivement
réservé aux savants et à la jeunesse : le second, que les parents pourront être témoins des leçons données à leurs enfants : le troisième, enfin, que les jeunes gens mis en quelque sorte sous les
yeux du public, en auront plus d'émulation, et prendront de bonne heure l'habitude de parler avec assurance, avec facilité, avec décence , habitude qu'un petit nombre d'exercices solennels ne
pourrait leur faire contracter. Dans les villes de garnison, on pourra charger le professeur d'art militaire d'ouvrir, pour les soldats, une conférence hebdomadaire, dont le principal objet sera
l'explication des lois et des règlements militaires, le soin de leur en développer l'esprit et les motifs ; car l'obéissance du soldat à la discipline ne doit plus se distinguer de la soumission
du citoyen à la loi ; elle doit être également éclairée et commandée par la raison et l'amour de la patrie, avant de l'être par la force ou la crainte de la peine.
Tandis qu'on enseignera, dans les instituts, la théorie élémentaire des sciences médicales, théorie suffisante pour éclairer la pratique de l'art,
les médecins de hôpitaux pourront enseigner cette pratique, et donner des leçons de chirurgie ; de manière qu'en multipliant les écoles où l'on recevra ces connaissances élémentaires, mais
justes, on puisse assurer à la partie la plus pauvre des citoyens les secours d'hommes éclairés, formés par une bonne méthode, instruits dans l'art d'observer, et libres des préjugés de
l'ignorance comme de ceux des doctrines systématiques.
Dans les ports de mer, des professeurs particuliers d'hydrographie, de pilotage, pourront enseigner l'art nautique à des élèves que les leçons de
mathématiques, d'astronomie, de physique, qui font partie de l'enseignement général, auront déjà préparés. Ailleurs, à l'aide de ces mêmes leçons, un petit nombre de maîtres suffira pour former
d'autres élèves à la pratique de l'art des constructions ; et dans tous les genres, cette distribution de l'instruction commune rendra plus simple et moins dispendieuse toute espèce d'instruction
particulière dont l'utilité publique exigerait l'établissement.
Les principes de la morale enseignés dans les écoles et dans les instituts, seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison,
appartiennent également à tous les hommes. La Constitution, en reconnaissant le droit qu'a chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de la
France, ne permet point d'admettre, dans l'instruction publique, un enseignement qui, en repoussant les enfants d'une partie des citoyens, détruirait l'égalité des avantages sociaux, et donnerait
à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière, et de
n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux. Chacun d'eux doit être enseigné dans les temples par ses propres ministres. Les parents, quelle que soit leur
opinion sur la nécessité de telle ou telle religion, pourront alors sans répugnance envoyer leurs enfants dans les établissements nationaux ; et la puissance publique n'aura point usurpé sur les
droits de la conscience, sous prétexte de l'éclairer et de la conduire. D'ailleurs, combien n'est-il pas important de fonder la morale sur les seuls principes de la raison ! Quelque changement
que subissent les opinions d'un homme dans le cours de sa vie, les principes établis sur cette base resteront toujours également vrais, ils seront toujours invariables comme elle ; il les
opposera aux tentatives que l'on pourrait faire pour égarer sa conscience ; elle conservera son indépendance et sa rectitude, et on ne verra plus ce spectacle si affligeant d'hommes qui
s'imaginent remplir leurs devoirs en violant les droits les plus sacrés, et obéir à Dieu en trahissant leur patrie. Ceux qui croient encore à la nécessité d'appuyer la morale sur une religion
particulière, doivent eux-mêmes approuver cette séparation : car, sans doute, ce n'est pas la vérité des principes de la morale qu'ils font dépendre de leurs dogmes ; ils pensent seulement que
les hommes y trouvent des motifs plus puissants d'être justes ; et ces motifs n'acquerront-ils pas une force plus grande sur tout esprit capable de réfléchir, s'ils ne sont employés qu'à
fortifier ce que la raison et le sentiment intérieur ont déjà commandé ? Dira-t-on que l'idée de cette séparation s'élève trop au-dessus des lumières actuelles du peuple ? Non, sans doute ; car,
puisqu'il s'agit ici d'instruction publique, tolérer une erreur, ce serait s'en rendre complice ; ne pas consacrer hautement la vérité, ce serait la trahir. Et quand bien même il serait vrai que
des ménagements politiques dussent encore, pendant quelque temps, souiller les lois d'une nation libre ; quand cette doctrine insidieuse ou faible trouverait une excuse dans cette stupidité,
qu'on se plaît à supposer dans le peuple pour avoir un prétexte de le tromper ou de l'opprimer ; du moins, l'instruction qui doit amener le temps où ces ménagements seront inutiles, ne peut
appartenir qu'à la vérité seule, et doit lui appartenir tout entière.
Nous avons donné le nom de lycée au quatrième degré d'instruction ; toutes les sciences y sont enseignées dans toute leur étendue. C'est là que se
forment les savants, ceux qui font de la culture de leur esprit, du perfectionnement de leurs propres facultés une des occupations de leur vie, ceux qui se destinent à des professions où l'on ne
peut obtenir de grands succès que par une étude approfondie d'une ou plusieurs sciences. C'est là aussi que doivent se former les professeurs. C'est au moyen de ces établissements que chaque
génération peut transmettre à la génération suivante ce qu'elle a reçu de celle qui l'a précédée, et ce qu'elle a pu y ajouter.
Nous proposons d'établir en France neuf lycées. Les lumières, en partant de plusieurs foyers à la fois, seront répandues avec plus d'égalité, et se
distribueront dans une plus grande masse de citoyens. On sera sûr de conserver dans les départements un plus grand nombre d'hommes éclairés, qui, forcés d'aller achever leur instruction à Paris,
auraient été tentés de s'y établir, et d'après la forme de la Constitution cette considération est très importante.
En effet, la loi oblige à choisir les députés à la législature parmi les citoyens de chaque département, et quand elle n'y obligerait pas, l'utilité
commune l'exigerait encore, du moins pour une très grande partie. Les administrateurs, les juges sont pris également dans le sein du département où ils exercent leurs fonctions. Comment
pourrait-on prétendre qu'on n'a rien négligé pour préparer à la Nation des hommes capables des fonctions les plus importantes, si une seule ville leur présentait les moyens de s'instruire ?
Comment pourrait-on dire que l'on a offert à tous les talents les moyens de se développer, qu'on en a laissé échapper aucun, si, dans un Empire aussi étendu que la France, ils ne trouvaient que
dans un seul point la possibilité de se former ?
D'ailleurs, il n'aurait pas été sans inconvénient pour le succès, et surtout pour l'égalité de l'instruction commune, de n'ouvrir aux professeurs
des instituts qu'une seule école, et de l'ouvrir à Paris. On a fixé le nombre des lycées à neuf parce qu'en comparant ce nombre à celui des grandes universités d'Angleterre, d'Italie,
d'Allemagne, il a paru répondre à ce qu'exigeait la population de la France. En effet, sans que le nombre des élèves puisse nuire à l'enseignement, un homme sur 1 600 pourra suivre un cours
d'études dans les lycées ; et cette proportion est suffisante pur une instruction nécessaire seulement à un petit nombre de professions où l'on n'enseigne que la partie des sciences qui l'élève
au-dessus des éléments.
L'enseignement que nous proposons d'établir est plus complet, la distribution en est plus au niveau de l'état actuel des sciences en Europe, que
dans aucun des établissements de ce genre qui existe dans les pays étrangers : nous avons cru qu'aucune espèce d'infériorité ne pouvait convenir à la Nation française et puisque chaque année est
marquée dans les sciences par des progrès nouveaux, ne pas surpasser ce qu'on trouve établi, ce serait rester au-dessous.
Quelques-uns de ces lycées seront placés de manière à y attirer les jeunes étrangers. L'avantage commercial qui en résulte, est peu important pour
une grande Nation : mais celui de répandre sur un plus grand espace les principes de l'égalité et de la liberté, mais cette réputation que donne à un peuple l'affluence des étrangers qui viennent
y chercher des lumières, mais les amis que ce peuple s'assure parmi ces jeunes gens élevés dans son sein, mais l'avantage immense de rendre sa langue plus universelle, mais la fraternité qui peut
en résulter entre les nations, toutes ces vues d'une utilité plus noble ne doivent pas être négligées.
Quelques lycées doivent donc être placés à portée des frontières dans leur distribution générale sur la surface de l'empire, on doit éviter toute
disproportion trop grande entre leurs distances respectives. Les villes qui renferment déjà de grands établissements consacrés, soit à l' instruction, soit au progrès des sciences, ont droit à
une préférence fondée sur des vues d'économie, et sur l'intérêt même de l'enseignement. Enfin, nous avons pensé que des villes moins considérables, où l'attention générale des citoyens pourrait
se porter sur ces institutions, où l'esprit des sciences ne serait pas étouffé par de grands intérêts, où l' opinion publique n'aurait pas assez de
force pour exercer sur l'enseignement une influence dangereuse, et l'asservir à des vues
locales, présenteraient plus d'avantages que les grandes villes de commerce, d' où une plus grande cherté des choses nécessaires à la vie éloignerait les enfants des familles pauvres, tandis que
les parents pourraient encore y craindre des séductions plus puissantes, des occasions plus multipliées de dissipation et de dépense. Nous n'avons pas étendu cette dernière considération jusque
sur Paris. La voix unanime de l'Europe, qui, depuis un siècle, regarde cette ville comme une des capitales du monde savant, ne le permettrait pas. C'est en combinant entre eux ces divers
principes, en accordant plus ou moins à chacun d'eux, que nous avons déterminé l'emplacement des lycées. Le lycée de Paris ne différera des autres que par un enseignement plus complet des langues
anciennes et modernes, et peut-être par quelques institutions consacrées aux arts agréables ; objets qui, par leur nature, n'exigeaient qu'un seul établissement pour la France. Nous avons cru qu'
une institution où toutes les langues connues seraient enseignées, où les hommes de tous les pays trouveraient un interprète, où l'on
pourrait analyser, comparer toutes les manières suivant lesquelles les hommes ont formé et classé leurs idées, devait conduire à des découvertes
importantes, et faciliter les moyens d'un rapprochement entre les peuples, qu'il n'est plus temps de reléguer parmi les chimères philosophiques.
C'est dans les lycées que des jeunes gens dont la raison est déjà formée, s'instruiront par l'étude de l'Antiquité, et s'instruiront sans danger,
parce que, déjà capables de calculer les effets de la différence des moeurs, des gouvernements, des langages, du progrès des opinions ou des idées, ils pourront à la fois, sentir et juger les
beautés de leurs modèles. L'instruction dans les lycées sera commune aux jeunes gens qui complètent leur éducation, et aux hommes. On a vu plus d'une fois, à Paris, des membres des académies
suivre exactement les leçons du collège royal et plus souvent assister à quelques-unes dont l'objet leur offrait un intérêt plus vif. D'ailleurs, des bibliothèques plus complètes, des cabinets
plus étendus, de plus grands jardins de botanique et d'agriculture sont encore un moyen d'instruction, et on y joint celui de conférences publiques entre les professeurs, parce qu'on peut y
traiter des questions vers lesquelles les circonstances appellent la curiosité ; et qui ne peuvent entrer dans des leçons nécessairement assujetties à un ordre régulier.
Dans ces quatre degrés d'instruction, l'enseignement sera totalement gratuit. L'Acte constitutionnel le prononce pour le premier degré et le second,
ce qui peut aussi être regardé comme général, ne pourrait cesser d'être gratuit sans établir une inégalité favorable à la classe la plus riche, qui paye les contributions à proportion de ses
facultés, et ne payerait l'enseignement qu'à raison du nombre d'enfants qu'elle fournirait aux écoles secondaires.
Quant aux autres degrés, il importe à la prospérité publique de donner aux enfants des classes les plus pauvres, qui sont les plus nombreuses, la
possibilité de développer leurs talents : c'est un moyen non seulement d'assurer à la patrie plus de citoyens en état de servir, aux sciences plus d'hommes capables de contribuer à leurs progrès,
mais encore de diminuer cette inégalité qui naît de la différence des fortunes de mêler entre elles les classes que cette différence tend à séparer. L'ordre de la nature n'établit dans la société
d'autre inégalité que celle de l'instruction et de la richesse, et en étendant l'instruction, vous affaiblirez à la fois les effets de ces deux causes de distinction. L'avantage de l'instruction,
moins exclusivement réuni à celui de l'opulence, deviendra moins sensible, et ne pourra plus être dangereux ; celui de naître riche sera balancé par l'égalité, par la supériorité même des
lumières que doivent naturellement obtenir ceux qui ont un motif de plus d'en acquérir.
D'ailleurs, ni les lycées, ni les instituts n'attirant un nombre égal d'élèves, il résulterait de la non gratuité une différence trop grande dans
l'état des professeurs. Les villes opulentes, les pays fertiles auraient tous les instituteurs habiles, et ajouteraient encore cet avantage à tous les autres. Comme il existe des parties de
sciences, et ce ne sont pas toujours les moins utiles, qui appelleront un plus faible concours, il faudrait, ou établir des différences dans la manière de payer les professeurs, ou laisser entre
eux une excessive inégalité qui nuirait à cet espèce d'équilibre entre les diverses branches des connaissances humaines, si nécessaires à leurs progrès réels. Observons encore que l'élève d'un
institut ou d'un lycée dans lequel l'instruction est gratuite, peut suivre à la fois un grand nombre de cours, sans augmenter la dépense de ses parents ; qu'il est alors le maître de varier ses
études, d'essayer son goût et ses forces ; au lieu que si chaque nouveau cours nécessite une dépense nouvelle, il est forcé de renfermer son activité dans des limites plus étroites, de sacrifier
souvent à l'économie une partie importante de son instruction : et cet inconvénient n'existe encore que pour les familles peu riches. D'ailleurs, puisqu'il faut donner des appointements fixes aux
professeurs, puisque la contribution qu'on exigerait des écoliers devrait être nécessairement très faible, l'économie le serait aussi ; et la dépense volontaire qui en résulterait, tomberait
moins sur les familles opulentes que sur celles qui s'imposent des sacrifices pour procurer à des enfants, dont les premières années ont annoncé des talents, les moyens de les cultiver et de les
employer pour leur fortune.
Enfin, l'émulation que ferait naître, entre les professeurs, le désir de multiplier des élèves, dont le nombre augmenterait leur revenu, ne tient
pas à des sentiments assez élevés, pour que l'on puisse se permettre de la regretter. Ne serait-il pas à craindre qu'il ne résultât plutôt de cette émulation des rivalités entre les
établissements d'instruction ; que les maîtres ne cherchassent à briller plutôt qu'à instruire ; que leurs méthodes, leurs opinions même ne fussent calculées d'après le désir d'attirer à eux un
plus grand nombre d'élèves ; qu'ils ne cédassent à la crainte de les éloigner en combattant certains préjugés, en s'élevant contre certains intérêts ? Après avoir affranchi l'instruction de toute
espèce d'autorité, gardons-nous de l'assujettir à l'opinion commune : elle doit la devancer, la corriger, la former, et non la suivre et lui obéir.
Au-delà des écoles primaires, l'instruction cesse d'être rigoureusement universelle. Mais nous avons cru que nous remplirions le double objet, et
d'assurer à la patrie tous les talents qui peuvent la servir, et de ne priver aucun individu. de l'avantage de développer ceux qu'il a reçus, si les enfants qui en avaient annoncé le plus dans un
degré d'instruction, étaient appelés à en parcourir le degré supérieur, et entretenus aux dépens du trésor national, sous le nom d'élèves de la patrie.
D'après le plan du comité, trois mille huit cent cinquante enfants, ou environ, recevraient une somme suffisante pour leur entretien ; mille
suivraient l'instruction des instituts, six cents celle des lycées ; environ quatre cents en sortiraient chaque année pour remplir dans la société des emplois utiles, ou pour se livrer aux
sciences ; et jamais dans aucun pays la puissance publique n'aurait ouvert à la partie pauvre du peuple une source si abondante de prospérité et d'instruction ; jamais elle n'aurait employé de
plus puissants moyens de maintenir l'égalité naturelle.
On ne s'est pas même borné à encourager l'étude des sciences ; on n'a pas négligé la modeste industrie, qui ne prétendrait qu'à s'ouvrir une entrée
plus facile dans une profession laborieuse ; on a voulu qu'il y eût aussi des récompenses pour l'assiduité, pour l'amour du travail, pour la bonté, lors même qu'aucune qualité brillante n'en
relevait l'éclat ; et d'autres élèves de la patrie recevront d'elle leur apprentissage dans les arts d'une utilité générale.
Dans les écoles primaires et secondaires, les livres élémentaires seront le résultat d'un concours ouvert à tous les citoyens, à tous les hommes qui
seront jaloux de l'instruction publique ; mais on désignera les auteurs des livres élémentaires pour les instituts. On ne prescrira rien aux professeurs du lycée, sinon d'enseigner la science
dont les cours qu'ils sont chargés de donner porteront le nom. L'étendue des livres élémentaires destinés aux instituts, le désir de voir des hommes célèbres consentir à s'en charger, le peu
d'espérance qu'ils le voulussent, s'ils n'étaient pas sûrs que leur travail fût adopté, la difficulté de juger, tous ces motifs nous ont déterminés à ne pas étendre à ces éléments la méthode d'un
concours.
Nous nous sommes dit : toutes les fois qu'un homme justement célèbre dans un genre de science quelconque, voudra faire, pour cette science, un livre
élémentaire, qu'il regardera ce travail comme une marque de son zèle pour l'instruction publique, pour le progrès des lumières, cet ouvrage sera bon. C'est un homme célèbre en Europe qu'il faut
entendre ici ; et dès lors on n'a pas à craindre de se tromper sur le choix. Si, au contraire, on propose un concours, qui répondra d'obtenir un bon livre élémentaire ? Comment prononcer entre
dix ouvrages, par exemple, dont chacun serait un cours élémentaire de mathématique ou de physique, en deux volumes ? Est-on bien sûr que les juges se dévoueront à l'ennui de cet examen ? Est-on
bien sûr qu'il leur soit même possible de bien juger ? Quelques vues philosophiques, quelques idées fines, ingénieuses, qu'ils remarqueront dans un ouvrage,ne feront-elles point pencher la
balance en sa faveur, avec dépens de la méthode ou de la clarté ?
Dans les trois premiers degrés d'instruction, on n'enseigne que des éléments plus ou moins étendus : il est pour chaque science, pour chacune de ses
divisions, une limite qu'il ne faut point passer. Il faut donc que la puissance publique indique les livres qu'il convient d'enseigner ; mais dans les lycées où la science doit s'enseigner tout
entière, alors c'est au professeur à choisir les méthodes. Il en résulte un avantage inappréciable : c'est d'empêcher l'instruction de jamais se corrompre : c'est d'être sûr que si, par une
combinaison de circonstances politiques, les livres élémentaires ont été infectés de doctrines dangereuses, l'enseignement libre des lycées empêchera les effets de cette corruption ; c'est de
n'avoir pas à craindre que jamais le langage de la vérité puisse être étouffé.
Enfin, le dernier degré d'instruction est une société nationale des sciences et des arts, instituée pour surveiller et diriger les établissements
d'instruction, pour s'occuper du perfectionnement des sciences et des arts, pour recueillir, encourager, appliquer et répandre les découvertes utiles. Ce n'est plus de l'instruction particulière
des enfants, ou même des hommes, qu'il s'agit, mais de l'instruction de la génération entière, du perfectionnement général de la raison humaine ; ce n'est pas aux lumières de tel individu en
particulier qu'il s'agit d'ajouter des lumières plus étendues ; c'est la masse entière des connaissances qu'il faut enrichir par des vérités nouvelles ; c'est à l'esprit humain qu'il faut
préparer de nouveaux moyens d'accélérer les progrès, de multiplier ses découvertes.
Nous proposons de diviser cette société en quatre classes, qui tiendront séparément leurs séances. Une société unique trop nombreuse eût été sans
activité : ou bien réduite à un trop petit nombre de membres pour chaque science, elle n'eût plus excité d'émulation ; et les mauvais choix, qu'il est impossible d'éviter toujours, y auraient été
trop dangereux. D'ailleurs, elle aurait été formée de trop de parties hétérogènes ; les savants qui l'auraient composée, y auraient parlé trop de diverses langues, et la plupart des lectures, ou
des discussions, y auraient été indifférentes à un trop grand nombre des auditeurs. D'un autre côté, nous avons voulu éviter la multiplicité des divisions : une société, occupée d'une seule
science, est trop facilement entraînée à contracter un esprit particulier, à devenir une espèce de corporation. Enfin, il importe au progrès des sciences de rapprocher, et non de diviser celles
qui se tiennent par quelques points. Tandis que chacune fait des progrès, s'enrichit des découvertes qui lui sont propres, ces points de contact se multiplient, ces applications d'une science à
une autre offrent une moisson féconde en découvertes utiles ; et tel doit être l'effet de l'accroissement des lumières, que bientôt aucune science ne sera plus isolée, qu'aucune ne sera
totalement étrangère à aucune autre.
C'est d'après ces vues que nous avons formé les divisions de la société nationale. La première classe comprend toutes les sciences mathématiques.
Depuis un siècle aucune société savante n'a imaginé de les séparer. Passant, par d'insensibles degrés, de celles qui n'emploient que le calcul, à celles qui ne se fondent que sur l'observation,
presque toutes, aujourd'hui, peuvent employer ces deux moyens de reculer les bornes des connaissances humaines ; et il est utile que ceux qui savent le mieux employer l'un ou l'autre de ces
instruments de découvertes, s'entr'aident, s'éclairent mutuellement; que le chimiste, que le physicien empêchent le botaniste de se borner à la simple nomenclature des noms, à la description trop
nue des objets, ou rappellent à des travaux plus utiles le géomètre qui emploierait ses forces à des questions sur les nombres, à des subtilités métaphysiques.
La seconde classe renferme les sciences morales et politiques. Il est superflu, sans doute, de prouver qu'elles ne doivent pas être séparées, et
qu'on n'a pas dû les confondre avec d'autres.
La troisième comprend l'application des sciences mathématiques et physiques aux arts. Ici nous sommes écartés davantage des idées communes. Cette
classe embrasse la médecine et les arts mécaniques, l'agriculture et la navigation. Mais, d'abord nous avons cru devoir faire pour les applications usuelles des sciences, ce que nous avons fait
pour les sciences elles-mêmes. Nous avons trouvé que même les distances étaient moins grandes, et les communications plus multipliées ; qu'un médecin, par exemple, qui s'occuperait des hôpitaux,
de la manière de placer ou de remuer les malades dans certaines maladies, pour de grandes opérations, pour des pansements difficiles, trouverait de l'avantage dans sa réunion avec des mécaniciens
et des constructeurs ; qu'aucune distinction aussi marquée que celle des mathématiques pures, et de certaines parties des sciences physiques, ne pouvait être appliquée à ces arts ; qu'il ne
fallait pas séparer la médecine de l'art vétérinaire de l'agriculture, ni l'agriculture de l'art des constructions, de celui de la conduite des eaux, et qu'on ne pouvait rompre cette chaîne sans
briser une liaison utile. Il restait donc à voir si une de ces parties pouvait exiger pour elle seule la création d'une société isolée. La médecine, l'agriculture, la navigation, étaient celles
qui, pouvaient le plus y prétendre, et même elles auraient pu alléguer des établissements déjà formés en leur faveur. Mais, d'abord une société de marine, par exemple, ne peut subsister qu'en y
supposant réunies toutes les sciences sur lesquelles l'art naval est appuyé. Elle serait donc une société des sciences particulièrement appliqué à la marine, et une sorte de double emploi. De
même une société de médecine ne peut se soutenir qu'en appelant des anatomistes, des botanistes, des chimistes. Celle d'agriculture aura des botanistes, des minéralogistes, des chimistes, des
hommes occupés d'économie politique et de commerce etc.
Or, qu'en résultera-t-il ? Une diminution de considération pour ces sociétés particulières, parce que les savants qui les composeront regarderont
une place dans la société qui embrassera la généralité des sciences, comme un objet plus digne d'exciter leur émulation. Il faudra donc, ou que l'on soit de deux, de trois sociétés à la fois ; ce
qui n'a aucun avantage que de nourrir la vanité, ce qui nuit à l'égalité : ou bien qu'il soit permis de passer de l'une à l'autre; ce qui produirait des changements continuels, nuisibles à celle
qui, ayant une moindre considération, serait habituellement abandonnée : ou enfin, qu'on reste irrévocablement fixé dans l'une d'elles ; ce qui aurait l'inconvénient non moins grand d'exclure des
sociétés consacrées à une seule science, les hommes qui prétendraient à celle où elles sont toutes réunies. D'ailleurs, je demanderai combien, par exemple, on trouvera d'hommes qui, n'étant ni
assez grands géomètres, ni assez habiles mécaniciens, pour être placés comme tels dans une société savante, peuvent cependant accélérer les progrès de la science navale ; combien vous trouverez
d'agriculteurs qui, sans avoir un nom dans la botanique, auront réellement contribué à quelque grand progrès de l'agriculture ; combien de médecins ou de chirurgiens célèbres comme tels, et non
par leurs découvertes dans les sciences. Le talent pour ces applications, en le séparant du génie des sciences, ne peut être le partage d'un assez grand nombre d'hommes, pour en former un corps à
part ; et loin de nuire à ces arts importants, c'est au contraire les servir que de les réunir dans une grande société, où chacun d'eux obtienne un petit nombre de places. D'ailleurs, ces
sociétés, si elles étaient séparées, deviendraient en quelque sorte une puissance élevée au-dessus de ceux qui cultivent chacune des professions qui y répondent ; réunies, elles ne peuvent en
être une à l'égard de la généralité des citoyens partagés entre ces professions diverses.
La quatrième classe renferme la grammaire, les lettres, les arts d'agrément, l'érudition. Dans l'enseignement public, dans la société nationale, les
arts d'agrément, comme les arts mécaniques, ne doivent être considérés que relativement à la théorie qui leur est propre. On a pour objet de remplir cet intervalle qui sépare la science
abstraite, de la pratique ; la philosophie d'un art, de la simple exécution. C'est dans les ateliers du peintre comme de l'artisan ou du manufacturier, que l'art proprement dit doit être enseigné
par l'exercice même de l'art. Aussi nos écoles ne dispensent point d'aller dans les ateliers ; mais on y apprend à connaître les principes de ce qu' on doit ailleurs apprendre à exécuter. C'est
le moyen d' établir dans tous les arts, dans tous les métiers même, une pratique éclairée ; de réunir par le lien d'une raison commune, d'une même langue, les hommes que leurs occupations
séparent le plus. Car jamais nous n' avons perdu de vue cette idée de détruire tous les genres d'inégalité, de multiplier entre les hommes que la nature et les lois attachent au même sol et aux
mêmes intérêts, des rapports qui rendent leur réunion plus douce et plus intime.
La distribution du travail dans les grandes sociétés établit entre les facultés intellectuelles des hommes une distance incompatible avec cette
égalité, sans laquelle la liberté n'est, pour la classe moins éclairée, qu' une illusion trompeuse ; et il n'existe que deux moyens de détruire cette distance : arrêter partout, si même on le
pouvait, la marche de l' esprit humain ; réduire les hommes à une éternelle ignorance, source de tous les maux ; ou laisser à l'esprit toute son activité, et rétablir l'égalité en répandant les
lumières. Tel est le principe fondamental de notre travail ; et ce n'est pas dans le dix-huitième siècle que nous avons à craindre le reproche d'avoir mieux aimé tout élever et tout affranchir,
que de tout niveler par l'abaissement et la contrainte. Cet enseignement des arts s'élevant par degrés depuis les écoles primaires jusqu' aux lycées, portera dans toutes les divisions de la
société la connaissance des principes qui doivent y diriger la pratique de ces arts, répandra partout et avec promptitude les découvertes et les méthodes nouvelles, et ne répandra que celles dont
la bonté sera prouvée par l'expérience : il excitera l' industrie des artistes, et, l'empêchant en même temps de s' égarer, préviendra la ruine à laquelle leur activité et leur talent les
exposent lorsque l' ignorance de la théorie les abandonne à leur imagination ; et rien peut-être n'accélérera davantage le moment où la nation française atteindra dans les manufactures, dans les
arts, le point où elle se serait élevée dès longtemps, si les vices de la constitution et de ses lois n' avaient arrêté ses efforts et comprimé son industrie.
Dans le plan que nous proposons, chaque individu ne pourra être membre que d'une seule classe ; il pourra passer de l'une à l'autre ; ce qui n' a
point d'inconvénient, parce que chaque classe est trop bornée pour y admettre des savants qui n'y appartiennent pas essentiellement, qu'aucune n'admet de membre appartenant naturellement à une
autre, qu' aucune, enfin, n'a d'infériorité dans l'opinion. Par les mêmes raisons, ces passages seront très rares. Nous avons déjà observé que chaque classe de la société tiendrait des séances
séparément ; elles seront ouvertes au public, mais seulement pour que ceux qui cultivent les sciences puissent écouter les lectures, suivre les discussions, et sans que la nécessité de se faire
entendre des spectateurs, de se mettre à leur portée, de les intéresser ou de les amuser, influe sur l' ordre des séances, la forme des discussions ou le choix des lectures. Les membres d'une
classe auront droit de siéger dans toutes les autres, pourront prendre part aux discussions, lire des mémoires, insérer leurs ouvrages dans les recueils publiés par chacune ; et, par ce moyen, la
règle de n' appartenir qu' à une seule ne privera d' aucun avantage réel, ni les sciences, ni ceux qui en cultiveraient à la fois plusieurs. La vanité seule perdra celui d' allonger un nom de
quelques mots de plus. Chaque classe est divisée en sections ; chaque section a un nombre déterminé de membres, moitié résidant à Paris, moitié répandus dans les départements.
Cette division en sections est nécessaire, par la raison que la société est chargée de la surveillance de l'instruction ; et elle est encore utile
pour être sûr qu'aucune partie des sciences ne cessera un moment d'être cultivée. Or, c'est un des plus grands avantages qui puissent résulter de l'établissement d'une société savante. En effet,
chaque science a ses moments de vogue et ses moments d'abandon. Une pente naturelle porte les esprits vers celle où de nouveaux moyens ouvrent un champ vaste à des découvertes utiles ou
brillantes ; tandis que, dans une autre, le talent a presque épuisé les méthodes connues, et attend que le génie lui en montre de nouvelles. Ainsi, ces divisions seront utiles jusqu'au moment où
les sciences, s' étendant au delà de leurs limites actuelles, se rapprocheront, se pénétreront en quelque sorte, et n' en feront plus qu' une seule. La fixation du nombre des membres nous a paru
également utile. Sans cela, une société savante n' est plus un objet d' émulation ; d' ailleurs, elle cesse de pouvoir se gouverner elle-même ; elle est forcée de confier les travaux
scientifiques à un comité, et l'égalité y est détruite. C'est ce qu'on voit à la société royale de Londres.
Comment sept ou huit cents membres pourraient-ils avoir un droit égal de lire et de faire imprimer des mémoires, de prononcer sur ceux qui méritent
la préférence ? N'est-il pas évident que la très grande majorité serait hors d' état de produire de bons ouvrages, et même de bien juger ? Il faut donc ou borner le nombre des membres, ou avoir,
comme à Londres, un comité aristocratique, ou se réduire à une nullité absolue. La moitié de ces savants auront leur résidence habituelle dans les départements ; et cette distribution plus égale,
nécessaire au progrès des sciences d'observation, de celles dont l'utilité est la plus immédiate, aura encore l'avantage de répandre les lumières avec plus d'uniformité ; de les placer auprès d'
un plus grand nombre de citoyens ; d'exciter plus généralement le goût de l'étude et des recherches utiles ; de faire mieux sentir le prix des talents et des connaissances ; d' offrir partout à
l'ignorance des instructeurs et des appuis ; au charlatanisme, des ennemis prompts à le démasquer et à le combattre ; de ne laisser aux préjugés aucune retraite où ils puissent jeter de nouvelles
racines, se fortifier et s'étendre. Les membres de la société nationale se choisiront eux-mêmes.
La première formation une fois faite, si elle renferme à peu près les hommes les plus éclairés, on peut être sûr que la société en présentera
constamment la réunion. Depuis deux ans que l'on a beaucoup écrit contre l'esprit dominateur des académies, on a demandé de citer un seul exemple d'une découverte réelle qu'elles aient repoussée
; d'un homme dont la réputation lui ait survécu, et qui en ait été exclu autrement que par l'effet de l'intolérance politique ou religieuse ; d' un savant célèbre par des ouvrages connus dans
l'Europe, qui ait essuyé des refus répétés ; et personne n'a répondu. C'est que les choix se font d'après des titres publics, des titres qui ne disparaissent point ; c'est que l'erreur des
jugements peut être prouvée ; c'est que les savants et les gens de lettres dépendent de l'opinion publique ; c'est surtout qu' ils répondent de leurs choix à l'Europe entière. Cette dernière
observation est si vraie, que plus un genre de science a pour juges les hommes qui les cultivent dans les pays étrangers, plus aussi l'expérience a prouvé que les choix étaient à l'abri de tout
reproche ; et c'est encore un des motifs qui nous ont déterminés à borner le nombre des membres de la société nationale. En effet, tant que les noms connus dans l'Europe pourront remplir à peu
près la liste entière, les mauvais choix ne seront pas à craindre.
Cependant, on a pris de nouvelles précautions. D' abord, on formera une liste publique de candidats : ainsi, tous ceux qui cultivent les sciences,
qui les aiment, pourront, en connaissant les concurrents, apprécier les choix et exercer sur la société l'unique censure vraiment utile, celle de l' opinion armée du seul pouvoir de la vérité. La
classe entière, composée de savants dans plusieurs genres, qui prononcent d' après la renommée comme d'après leur jugement, réduira cette liste à un moindre nombre d' éligibles ; enfin, la
section choisira ; et la responsabilité, portant alors sur un petit nombre d' hommes qui ne jugent que de talents qu' ils doivent bien connaître, deviendra suffisante pour les contenir. Les
membres de la société nationale résidant dans les départements concourront aux élections avec une entière égalité ; ce qui oblige à prendre un mode d' élire tel, que la présentation et l'élection
se fassent nécessairement chacune par un seul voeu. L'exemple de la société italienne formée de membres dispersés, suffit pour en prouver la possibilité. Chaque classe de la société nationale
élit sous les mêmes formes les professeurs des lycées, dont l'enseignement correspond aux sciences qui sont l'objet de cette classe. Les professeurs du lycée nomment ceux des instituts ; mais la
municipalité aura le droit de réduire la liste des éligibles.
Quant aux instituteurs des écoles secondaires et primaires, la liste d'éligibles sera faite par les professeurs des instituts de l'arrondissement,
et le choix appartiendra pour les premiers, au corps municipal du lieu où l'école est située, pour les derniers à l'assemblée des pères de famille de l' arrondissement de l' école. En effet, les
professeurs, comme les instituteurs, doivent avoir des connaissances dont les corps administratifs ne peuvent être juges, qui ne peuvent être appréciées que par des hommes en qui l'on ait droit
de supposer une plus grande instruction. La liste d' éligibles qui constate la capacité doit donc être formée par les membres d' un établissement supérieur.
Mais, si dans le choix d'un professeur entre les éligibles, il faut préférer le plus savant, le plus habile ; dans celui des instituteurs, où les
élèves sont plus jeunes, où les qualités morales du maître influent sur eux davantage, où il ne s'agit que d'enseigner des connaissances très élémentaires, on doit prendre pour guide l'opinion,
ou de ceux que la nature a chargés du bonheur de la génération naissante, ou du moins de leurs représentants les plus immédiats.
C'est dans les mêmes vues que l'on donne aux municipalités le droit de réduire la liste des éligibles pour les professeurs des instituts. Les
convenances personnelles et locales y ont déjà quelque importance ; et ce droit d'exclusion suffit pour répondre qu'elles ne seront point trop ouvertement blessées. Des directoires formés dans la
société nationale, les lycées, les instituts, seront chargés de l'inspection habituelle des établissements inférieurs. Dans les circonstances importantes, la décision appartiendra à une des
classes de la société nationale, ou à l'assemblée des professeurs, soit du lycée, soit des instituts. Par ce moyen, l'indépendance de l'instruction sera garantie, et l'inspection n'exigera point
d'établissement particulier où l'on aurait pu craindre l'esprit de domination.
Comme la société nationale est partagée en quatre classes correspondantes à des divisions scientifiques ; comme, sur chaque objet important, le
droit de prononcer appartient à une classe seulement, on voit combien, sans nuire cependant à la sûreté de l'inspection, on est à l'abri de la crainte de voir les corps instruisants élever dans
l'état un nouveau pouvoir. L'unité n'est pas rompue, parce que les questions générales qui intéresseraient un établissement entier, ne peuvent être décidées que par des lois qu'il faudrait
demander au corps législatif. Si l'on compte toutes les sommes employées pour les établissements littéraires remplacés par les nouvelles institutions, les biens des congrégations enseignantes,
ceux des collèges, les appointements que les villes donnaient aux professeurs, les revenus des écoles de toute espèce ; si on y ajoute enfin ce qu'il en coûtait au peuple pour payer les maîtres
de ces écoles, on trouvera que la dépense de la nouvelle organisation de l' instruction publique ne surpassera pas de beaucoup, et peut-être n' égalera point ce que les institutions anciennes
coûtaient à la nation.
Ainsi, une instruction générale, complète, supérieure à ce qui existe chez les autres nations, remplacera, même avec moins de frais, ce système d'
éducation publique dont l'imperfection grossière offrait un contraste, si honteux pour le gouvernement, avec les lumières, les talents et le génie qui avaient su briser parmi nous tous les liens
des préjugés, comme tous les obstacles des institutions politiques.
Nous avons présenté dans ce plan l'organisation de l'instruction publique telle que nous avons cru qu'elle devait être, et nous en avons séparé la
manière de former les nouveaux établissements. Nous avons pensé qu'il fallait que l'Assemblée nationale eût déterminé ce qu'elle voulait faire, avant de nous occuper des moyens de remplir ses
vues. Dans les villages où il n'y aura qu'une seule école primaire, les enfants des deux sexes y seront admis, et recevront d'un même instituteur une instruction égale.
Lorsqu'un village ou une ville auront deux écoles primaires, l'une d'elles sera confiée à une institutrice, et les enfants des deux sexes seront
séparés. Telle est la seule disposition relative à l'instruction des femmes, qui fasse partie de notre premier travail ; cette instruction sera l'objet d'un rapport particulier ; et, en effet, si
l'on observe que dans les familles peu riches, la partie domestique de l'éducation des enfants est presque uniquement abandonnée à leurs mères ; si l'on songe que sur vingt-cinq familles livrées
à l'agriculture, au commerce, aux arts, une au moins a une veuve pour son chef, on sentira combien cette portion du travail qui nous a été confié est importante, et pour la prospérité commune, et
pour le progrès général des lumières. On pourra reprocher à ce système d'organisation de ne pas respecter assez l'égalité entre les hommes livrés à l'étude, et d'accorder trop d'indépendance à
ceux qui entrent dans le système de l' instruction publique.
Mais, d'abord, ce n'est pas ici une distinction qu'il s'agit d'établir, mais une fonction publique qu'il est nécessaire de conférer à des hommes
dont le nombre soit déterminé, dont la réunion soit assujettie à des formes régulières. La raison exige que les hommes chargés d'instruire, ou les enfants ou les citoyens, soient choisis par ceux
qu' on peut supposer avoir des lumières égales ou supérieures. La surveillance des établissements d'instruction n'exige-t-elle pas aussi cette même égalité, s'il s'agit de l'enseignement dans les
lycées ; cette supériorité, s'il s'agit de celui des établissements inférieurs ? Il fallait donc remonter à une réunion d'hommes qui pussent satisfaire à cette condition essentielle.
Laisserait-on le choix de ces hommes à la masse entière de ceux qui cultivent les sciences et les arts, ou qui prétendent les cultiver ?
Mais il n'y aurait plus aucun motif de ne pas appeler à ce choix la généralité des citoyens ; car si la prétention d' être savant suffisait pour
exercer ce droit, s'il suffisait de se réunir en un corps qui se donnât pour éclairé, il est bien évident que ces conditions n'excluraient, ni la profonde ignorance, ni les doctrines les plus
absurdes. D'ailleurs, ce serait autoriser de véritables corporations, des jurandes proprement dites ; car toute association libre à laquelle on donnerait une fonction publique quelconque,
prendrait nécessairement ce caractère. Ce n'est pas l'ignorance seule qui serait à craindre, c'est la charlatanerie qui bientôt détruirait, et l'instruction publique, et les arts et les sciences,
ou qui du moins emploierait pour les détruire tout ce que la nation aurait consacré à leurs progrès.
Enfin, la puissance publique choisirait-elle entre ces sociétés ; et alors à un corps composé d'hommes très éclairés, elle en substituerait de plus
nombreux où les lumières seraient plus faibles, où les hommes médiocres s'introduiraient avec plus de facilité, seraient moins aisément contenus par l'ascendant du génie et des talents
supérieurs, où enfin régnerait bientôt un ostracisme d'autant plus effrayant, que la médiocrité est facilement dupe ou complice de la charlatanerie, et n'étend pas sur elle cette haine de tout
succès brillant ou durable qui lui est si naturelle. Ou bien la puissance publique reconnaîtrait-elle toute espèce de société libre ; et alors chaque classe de charlatans aurait la sienne. Ce ne
serait pas l'ignorance modeste qui jugerait les talents d'après l'opinion commune, ce qui déjà serait un mal ; mais l'ignorance présomptueuse qui les jugerait d' après son orgueil ou son intérêt.
Au contraire, dans le plan que nous proposons, les sociétés libres ne peuvent que produire des effets salutaires. Elles serviront de censeurs à la société nationale, qui exercera sur elles en
même temps une censure non moins utile. Celles où le charlatanisme dominerait, s'anéantiraient bientôt, parce qu'aucune espérance de séduire l'opinion publique ne les soutiendrait. Chacune
d'elles, suivant l'étendue qu' elle donnerait à ses occupations, chercherait à n'être inférieure. Elles seraient surtout les juges naturels des choix de cette société, et par là elles
contribueraient plus à en assurer la bonté, que si elles y concouraient d' une manière directe.
Enfin, la société chargée de surveiller l'instruction nationale, de s'occuper des progrès des sciences, de la philosophie et des arts, au nom de la
puissance publique, doit être uniquement composée de savants ; c'est-à-dire, d'hommes qui ont embrassé une science dans toute son étendue, en ont pénétré toute la profondeur, ou qui l'ont
enrichie par des découvertes. Sans une telle société, puisque la connaissance des principes des arts est encore étrangère à presque tous ceux qui les cultivent ; puisque leur histoire n'est
connue que d'un petit nombre de savants, comment ne serait-on pas exposé à voir la nation et les citoyens accueillir, récompenser, mettre en oeuvre, comme autant de découvertes utiles, des
procédés ou des moyens depuis longtemps connus, et rejetés par une saine théorie, ou abandonnés après une expérience malheureuse ?
Les sociétés libres ne peuvent exister si elles n'admettent à la fois, et les savants, et les amateurs des sciences ; et c'est par là surtout qu'
elles en inspireront le goût, qu'elles contribueront à les répandre, qu'elles soutiendront, qu'elles perfectionneront les bonnes méthodes de les étudier ; c'est alors que ces sociétés
encourageront les arts sans en protéger le charlatanisme, qu' elles formeront pour les sciences une opinion commune des hommes éclairés qu' il sera impossible de méconnaître, et dont la nationale
ne sera plus que l'interprète.
En même temps, tout citoyen pouvant former librement des établissements d'instruction, il en résulte encore pour les écoles nationales l'invincible
nécessité de se tenir au moins au niveau de ces institutions privées ; et la liberté, ou plutôt l'égalité, reste aussi entière qu'elle peut l'être auprès d' un établissement public. Il ne faut
pas confondre la société nationale telle que nous l' avons conçue, avec les sociétés savantes qu'elle remplace. L'égalité réelle qui en est la base, son indépendance absolue du pouvoir exécutif,
la liberté entière d'opinions qu'elle partage avec tous les citoyens, les fonctions qui lui sont attribuées relativement à l'instruction publique, une distribution de travail qui la force à ne
s'occuper que d' objets utiles, un nombre égal de ses membres répandu dans les départements : toutes ces différences assurent qu' elle ne méritera pas les reproches souvent exagérés, mais
quelquefois justes, dont les académies ont été l'objet.
D'ailleurs, dans une constitution fondée sur l'égalité, on ne doit pas craindre de voir une société d'hommes éclairés contracter aisément cet esprit
de corporation si dangereux, mais si naturel dans un temps où tout était privilège. Alors chaque homme s'occupait d'obtenir des prérogatives ou de les étendre ; aujourd'hui tous savent que les
citoyens seuls ont des droits, et que le titre de fonctionnaire public ne donne que des devoirs à remplir. Cette indépendance de toute puissance étrangère, où nous avons placé l'enseignement
public, ne peut effrayer personne, puisque l'abus serait à l'instant corrigé par le pouvoir législatif, dont l'autorité s'exerce immédiatement sur tout le système de l' instruction.
L'existence d'une instruction libre et celle des sociétés savantes librement formées, n'opposeront-elles pas encore à cet abus une puissance
d'opinion d' autant plus imposante, que, sous une constitution populaire, aucun établissement ne peut subsister, si l'opinion n'ajoute sa force à celle de la loi ? D'ailleurs, il est une dernière
autorité à laquelle, dans tout ce qui appartient aux sciences, rien ne peut résister : c'est l'opinion générale des hommes éclairés de l'Europe ; opinion qu'il est impossible d'égarer ou de
corrompre : c'est d'elle seule que dépend toute célébrité brillante ou durable ; c'est elle qui, revenant s'unir à la réputation que chacun a d'abord acquise autour de lui, lui donne plus de
solidité et plus d'éclat ; c'est, en un mot, pour les savants, pour les hommes de lettres, pour les philosophes, une sorte de postérité anticipée dont les jugements sont aussi impartiaux, presque
aussi certains : et une puissance suprême au joug de laquelle ils ne peuvent tenter de se soustraire.
Enfin, l'indépendance de l'instruction fait en quelque sorte une partie des droits de l' espèce humaine. Puisque l'homme a reçu de la nature une
perfectibilité dont les bornes inconnues s'étendent, si même elles existent, bien au delà de ce que nous pouvons concevoir encore, puisque la connaissance de vérités nouvelles est pour lui le
seul moyen de développer cette heureuse faculté, source de son bonheur et de sa gloire, quelle puissance pourrait avoir le droit de lui dire : voilà ce qu'il faut que vous sachiez ; voilà le
terme où vous devez vous arrêter ? Puisque la vérité seule est utile, puisque toute erreur est un mal, de quel droit un pouvoir, quel qu' il fût, oserait-il déterminer où est la vérité, où se
trouve l' erreur ?
D'ailleurs, un pouvoir qui interdirait d'enseigner une opinion contraire à celle qui a servi de fondement aux lois établies, attaquerait directement
la liberté de penser, contredirait le but de toute institution sociale, le perfectionnement des lois ; suite nécessaire du combat des opinions et du progrès des lumières.
D'un autre côté, quelle autorité pourrait prescrire d'enseigner une doctrine contraire aux principes qui ont dirigé les législateurs ? On se
trouverait donc nécessairement placé entre un respect superstitieux pour les lois existantes, ou une atteinte indirecte, qui, portée à ces lois au nom d' un des pouvoirs institués par elles,
pourrait affaiblir le respect des citoyens ; il ne reste donc qu' un seul moyen : l'indépendance absolue des opinions, dans tout ce qui s' élève au-dessus de l'instruction élémentaire. C'est
alors qu' on verra la soumission volontaire aux lois, et l'enseignement des moyens d'en corriger les vices, d'en rectifier les erreurs, exister ensemble, sans que la liberté des opinions nuise à
l' ordre public, sans que le respect pour la loi enchaîne les esprits, arrête le progrès des lumières, et consacre des erreurs.
S'il fallait prouver par des exemples le danger de soumettre l'enseignement à l'autorité, nous citerions l'exemple de ces peuples, nos premiers
maîtres dans toutes les sciences, de ces indiens, de ces égyptiens, dont les antiques connaissances nous étonnent encore, chez qui l'esprit humain fit tant de progrès, dans les temps dont nous ne
pouvons même fixer l'époque, et qui retombèrent dans l'abrutissement de la plus honteuse ignorance, au moment où la puissance religieuse s'empara du droit d'instruire les hommes. Nous citerions
la Chine, qui nous a prévenus dans les sciences et dans les arts, et chez qui le gouvernement en a subitement arrêté tous les progrès, depuis des milliers d'années, en faisant de l'instruction
publique une partie de ses fonctions. Nous citerions cette décadence où tombèrent tout à coup la raison et le génie chez les romains et chez les grecs, après s'être élevés au plus haut degré de
gloire, lorsque l'enseignement passa des mains des philosophes à celles des prêtres. Craignons, d'après ces exemples, tout ce qui peut entraver la marche libre de l'esprit humain. à quelque point
qu'il soit parvenu, si un pouvoir quelconque en suspend le progrès, rien ne peut garantir même du retour des plus grossières erreurs ; il ne peut s'arrêter sans retourner en arrière : et du
moment où on lui marque des objets qu'il ne pourra examiner ni juger, ce premier terme mis à sa liberté, doit faire craindre que bientôt il n' en reste plus à sa servitude.
D'ailleurs, la constitution française elle-même nous fait de cette indépendance un devoir rigoureux. Elle a reconnu que la nation a le droit
inaliénable et imprescriptible de réformer toutes ses lois : elle a donc voulu que, dans l'instruction nationale, tout fût soumis à un examen rigoureux. Elle n'a donné à aucune loi une
irrévocabilité de plus de dix années. Elle a donc voulu que les principes de toutes les lois fussent discutés, que toutes les théories politiques pussent être enseignées et combattues, qu'aucun
système d'organisation sociale ne fût offert à l'enthousiasme ni aux préjugés, comme l'objet d' un culte superstitieux, mais que tous fussent présentés à la raison, comme des combinaisons
diverses entre lesquelles elle a le droit de choisir. Aurait-on réellement respecté cette indépendance inaliénable du peuple, si on s'était permis de fortifier quelques opinions particulières de
tout le poids que peut leur donner un enseignement général ; et le pouvoir qui se serait arrogé le droit de choisir ces opinions n'aurait-il pas véritablement usurpé une portion de la
souveraineté nationale ?
Le plan que nous présentons à l'Assemblée a été combiné d'après l'examen de l'état actuel des lumières en France et en Europe ; d'après ce que les
observations de plusieurs siècles ont pu nous apprendre sur la marche de l' esprit humain dans les sciences et dans les arts ; enfin, d'après ce qu' on peut attendre et prévoir de ses nouveaux
progrès. Nous avons cherché ce qui pourrait plus sûrement contribuer à lui donner une marche plus ferme, à rendre ses progrès plus rapides. Il viendra, sans doute, un temps où les sociétés
savantes, instituées par l'autorité, seront superflues, et dès lors dangereuses, où même tout établissement public d'instruction deviendra inutile : ce sera celui où aucune erreur générale ne
sera plus à craindre, où toutes les causes qui appellent l'intérêt ou les passions au secours des préjugés, auront perdu leur influence ; où les lumières seront répandues avec égalité et sur tous
les lieux d'un même territoire, et dans toutes les classes d'une même société ; où toutes les sciences et toutes les applications des sciences seront également délivrées du joug de toutes les
superstitions et du poison des fausses doctrines ; où chaque homme, enfin, trouvera dans ses propres connaissances, dans la rectitude de son esprit, des armes suffisantes pour repousser toutes
les ruses de la charlatanerie : mais ce temps est encore éloigné ; notre objet devait être d'en préparer, d'en accélérer l'époque ; et, en travaillant à former ces institutions nouvelles, nous
avons dû nous occuper sans cesse de hâter l'instant heureux où elles deviendront inutiles."
Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat,
marquis de Condorcet
![montage-comite_1.png]()
![]()